L'HISTOIRE DU MAROC
- 2 nov. 2024
- 40 min de lecture

Nom officiel Royaume du Maroc (MA)
Chef de l'État SM le roi Mohammed 6 (depuis le 23 juillet 1999)
Chef du gouvernement Aziz Akhannouch (depuis le 7 octobre 2021)
Capitale Rabat
Langues officielles Arabe, tamazight (langue berbère)
Unité monétaire Dirham marocain (MAD)
Population (estim.) 36 769 000 (2024)
Superficie 417 000 km²
Le Maroc, pays du soleil couchant, Maghrib al-'aqṣā, offre, dans l'ensemble de l'Afrique du Nord, une histoire originale. Il la doit sans doute à la puissante personnalité de ses peuples restés tout au long des siècles moins marqués des influences extérieures, notamment arabe, que l'Algérie et la Tunisie, mais tout autant à de vigoureux traits géographiques.
Bien qu'elle soit originale et qu'elle comporte de nombreux traits d'insularité, l'histoire du Maroc n'est pas celle d'un pays isolé, et l'on y retrouve les fluctuations de l'histoire mondiale : formation des grands empires de l'Antiquité, islamisation de la Méditerranée méridionale, influences des grandes découvertes, de l'impérialisme européen et de la décolonisation.
Le Maroc moderne illustre bien cette situation : cadre d'une lutte pour l'indépendance, acquise en 1956, il conserve cependant la structure de pouvoir monarchique antérieure à l'établissement du protectorat français.
Géographie

Parmi les pays de l'Afrique du Nord, le Maroc se distingue à la fois par l'altitude plus élevée de ses montagnes et par la remarquable extension des plaines et des plateaux. Le Haut Atlas occidental compte plusieurs sommets dépassant quatre mille mètres, dont le djebel Toubkal (4 165 m) qui est le point culminant de toute l'Afrique du Nord. En revanche, les surfaces planes ou peu accidentées couvrent près des deux tiers du pays.
Dans l'ensemble des montagnes marocaines, le Rif, au nord, est un système à part dont la structure en nappes s'apparente à celle des unités telliennes d'Algérie. Relativement peu élevé (2 450 m au djebel Tidighine), le Rif est cependant une chaîne compliquée, déversée vers le sud, arquée et allongée d'est en ouest. Comme l'Atlas tellien qu'il prolonge, il contribue à l'isolement du littoral méditerranéen.
Au sud, le Haut Atlas, orienté est-nord-est - ouest-sud-ouest, est aussi dans le prolongement des montagnes algériennes de l'Atlas saharien. C'est un énorme pli de fond soulevant, entre de grandes cassures, un bloc de roches anciennes, le Haut Atlas occidental, avec sa couverture secondaire, le Haut Atlas central et oriental. Cette chaîne rigide élevée, mais franchissable en deux ou trois endroits (Talremt, Tichka, Tizi-n-Test), tombe sur la mer par des plateaux tranchés brutalement par la côte.
Population et organisation du territoire
À la fin des années 2000, le Maroc compte plus de 30 millions d'habitants (33,7 millions d'hab. d'après les estimations de 2007, y compris les populations résidant au Sahara occidental), et se place au deuxième rang des pays d'Afrique du Nord. Les effectifs de la population ont été multipliés par six au cours du 20e siècle, passant de moins de 5 millions en 1900 à 10 millions en 1956 et à 20 millions en 1982. La densité moyenne de la population, 66 habitants par kilomètre carré, ne rend pas compte des déséquilibres démographiques entre les seize régions officielles (y compris les provinces sahariennes « revendiquées »).µ
Le Maroc antique
Le Maroc sort de l'ombre de la préhistoire et des mythes de la légende au moment où la thalassocratie phénicienne y établit ses comptoirs. Les premières installations à Liks (Larache), Tingi (Tanger) puis Tamuda (Tétouan) permettent les échanges avec l'intérieur et sont des relais sur la route de l'or. Le périple d'Hannon, entre 475 et 450 avant J.-C., mené jusqu'au Gabon, peut apparaître, malgré les obscurités dont il reste entouré, comme l'« acte de naissance de l'histoire marocaine ». Les colonies phéniciennes, pendant près d'un millénaire, diffusent, parmi les tribus locales, leur civilisation avec l'usage des métaux et de plantes nouvelles, leur langue et leur culte.
Ici comme dans le reste de l' Afrique du Nord, Rome succède à Carthage. Son influence se fera d'abord sentir par l'intermédiaire des dynasties locales qui inaugurent une brillante civilisation berbéro-romaine. De ces souverains, Juba II, qui règne des hauts plateaux orientaux à l'Atlantique de 25 avant J.-C. à 23 après J.-C., est le plus célèbre. L'annexion proclamée en 40, Ptolémée, son fils, va transformer le nord du pays en province romaine, la Mauritanie Tingitane, que la Moulouïa sépare de la Césarée, ou province de Cherchell. Au-delà, vers le sud, des postes avancés et des comptoirs élargissent l'influence romaine. La Mauritanie, dirigée d'abord par un procurator, sera rattachée à la Bétique en 285. La province est mise en valeur par la création de routes et de villes (Volubilis), par le développement agricole et un commerce actif.
À la fin du IIIe siècle, dans la crise que traverse l'Empire, le Maroc romain est progressivement abandonné ; seuls sont conservés, avec la région de Tanger, certains points de la côte comme Essaouira (Mogador). L'intérieur s'enfonce dans les « siècles obscurs » (E. F. Gauthier). Dans l'effondrement de l'Empire romain, au moment où arrivent les Vandales, la présence chrétienne semble se maintenir vivace et les cités poursuivre leur existence.
Islamisation et grandes dynasties berbères (VIIe-XVe s.)

Avec l'islamisation, l'Afrique du Nord, échappant à la latinité et au christianisme, se trouve désormais rattaché au monde de la Méditerranée orientale. L' Islam tente de recréer à son profit l'unité de la mer intérieure et va, non sans difficulté, soumettre l'Afrique du Nord entre le milieu du VIIe siècle et le début du VIIIe. Avec Mūsā b. Nuṣayr, gouverneur de l'Ifrīqiya (l'actuelle Tunisie), commencent l'organisation de la conquête et la soumission des Berbères par la conversion et l'enrôlement dans les armées arabes partant pour la conquête de l'Espagne. Dans cette première phase, si importante dans le domaine culturel (l'arabe) et le religieux (l'islam), le Maroc reste divisé en tribus ou confédérations berbères plus ou moins indépendantes dont une des plus remarquables, celle des hérétiques Barghawāṭa, constituera, jusqu'au XIIe siècle, une entité politique sur l'Oum er-R'bia.
Le royaume idrīside (686-917)
Le pays va sortir de cette confusion avec la constitution du royaume idrīside. Idrīs Ier, échappé au massacre des descendants du Prophète en 786, s'est réfugié en Afrique du Nord et s'installe à Oulila (Volubilis). Bien accueilli, usant de son autorité religieuse, habile à nouer des relations avec les tribus, il étend son autorité. Son fils Idrīs II continue son œuvre. Il élargit le royaume vers le sud et l'est. Contrôlant le carrefour des routes marocaines, il développe Fès dont il est sinon le fondateur, du moins le véritable créateur. Il donne ainsi au Maroc sa capitale qui dispose d'une excellente situation géographique. Tôt renforcée d'immigrés de Cordoue ou de Kairouan, elle devient un important centre intellectuel et religieux. La mort d'Idrīs II remet en cause son œuvre d'unification. Les difficultés de succession s'aggravent des rivalités entre Fāṭimides, qui se sont imposés en Ifrīqiya, et Omeyyades de Cordoue, pour lesquels le Maroc est enjeu d'importance. De ces luttes religieuses, tribales, politiques et des rivalités économiques, le détail échappe à l'historien. Cependant, à travers la décadence idrīside se maintient un important commerce, notamment vers le Sahara d'où arrivent l'or et les esclaves. À l'occasion de ces troubles du IXe et du Xe siècle, où se sont affrontées les trois grandes influences de l'histoire du Maroc, l'écart s'accroît entre la prospérité de l'ouest de l'Afrique du Nord et l'appauvrissement de l'est ravagé par les invasions des nomades hilāliens et maqils.
Des conquérants réformistes : les Almoravides
L'apparition de la dynastie des Almoravides (al-murābiṭūn, les gens du ribāt) fait pour longtemps prédominer les influences du Sud sur celles de l'Orient. La tribu des Lamtūna, maîtresse des routes caravanières du Sahara marocain, poussée par le désir des riches terres du Nord et par le zèle réformiste dont l'a enflammée le prédicateur 'Abd Allāh b. Yāsīn dans le ribāt (couvent) du Sénégal, conquiert en quelques années le Maroc et crée un vaste empire ibéro-nord-africain. Premier exemple des mouvements qui vont désormais marquer l'histoire du pays : l'union d'une passion religieuse, d'une poussée ethnique, d'une ambition économique porte au pouvoir une nouvelle dynastie.

La grande cité caravanière de Sidjilmāsa, carrefour des routes sahariennes, est enlevée en 1054, la capitale du Sous, Taroudant, en 1057. Sous la conduite de Yūsuf b. Tāshfīn, les conquérants débordent au nord de l'Atlas. La fondation de Marrakech, en 1062, fournit au Maroc sa deuxième capitale, inaugure le nouveau destin bâtisseur de ces nomades. Fès prise en 1069, les Almoravides poussent vers l'ouest, jusqu'en Kabylie. Mais c'est essentiellement dans l'axe nord-sud que s'affirme le nouvel empire.
En Espagne, la reconquête chrétienne (Tolède est prise en 1085) menace les princes musulmans, les reyes de taifas, raffinés et divisés. Yūsuf b. Tāshfīn vient au secours de l'Islam, remporte la victoire de Zellaca (1086) sur les troupes d'Alphonse VI de Castille, se retourne contre les principautés musulmanes qu'il enlève les unes après les autres. La dernière fut Valence, défendue par le Cid, en 1103. Au sud, battant l'empire de Ghāna en 1077, les Almoravides avaient assuré leur contrôle des routes de l'or. Ainsi est constitué, au début du XIIe siècle, un immense empire s'étendant sur l'Espagne musulmane, l'Afrique du Nord occidental et central, le Sahara. La prospérité économique, fondée sur les échanges complémentaires entre le Nord et le Sud et sur le contrôle des routes vers l'Afrique noire, entretient une importante renaissance artistique, symbiose entre les influences andalouse, marocaine et saharienne.
L'épopée des Almoravides ouvre une période de domination marocaine dans l'Islam occidental. Pourtant, leur empire est bientôt menacé. Les descendants des grands fondateurs n'ont point leur valeur. La vie religieuse se sclérose rapidement, laissant s'éteindre la flamme réformatrice. L'étendue même des possessions favorise les mouvements séparatistes. Faiblesses internes d'autant plus graves que les chrétiens en Espagne se font plus menaçants tandis que les tribus berbères réfractaires de l'Atlas sont acquises au mouvement almohade, né lui aussi d'une réaction religieuse, d'une poussée ethnique, d'ambitions économiques.
Les Almohades, Berbères puritains
Ibn Tūmart, originaire du sud du Maroc, s'est retiré, après des études en Orient, près de Bougie où se confirme sa vocation de réformateur et de prédicateur. Réfugié à Tinmāl dans le Haut Atlas, au milieu des Berbères Maṣmūda, il prêche le retour au Coran et à la tradition, le puritanisme et la doctrine de l'unicité de Dieu contre les déviations et l'impiété almoravides. Il constitue une forte communauté inspirée des traditions berbères (groupe des Dix, conseil des Cinquante, etc.).
C'est à son disciple 'Abd al-Nu'min, à ses qualités et à ses ambitions que le mouvement doit sa fortune. La conquête de la montagne isole le Maroc atlantique du commerce saharien, permet d'enlever Fès en 1145, Marrakech en 1147. Déjà les troupes almohades sont intervenues en Espagne. Elles s'emparent alors rapidement de l'ensemble de l'Afrique du Nord.

Une forte organisation noue les différentes parties de l'empire et s'efforce, non sans difficulté, de maintenir l'unité contre les multiples oppositions qui subsistent en Afrique du Nord et devant les menaces chrétiennes en Espagne. Le règne de Ya'qūb al-Manṣūr (1184-1199) est l'apogée de la civilisation almohade : la vie de la cour où se retrouvent les plus grands esprits de tout l'Occident musulman est brillante, les constructions remarquables par leur taille et leur beauté.
Mais là encore l'effondrement est proche : la destinée de la dynastie almohade rappelle, par sa fin comme par ses origines, celle de la dynastie almoravide. Les luttes de succession, la faiblesse des souverains, l'immensité de l'empire qui encourage des tendances centrifuges menacent l'œuvre. La victoire chrétienne de Las Navas de Tolosa amorce, en 1212, un renversement décisif des forces en Espagne : Séville tombe en 1248 au moment où les Almohades perdent le contrôle des routes sahariennes.
Dès 1269 le Maroc passe aux mains des Mérinides, tribu berbère des hauts plateaux. Ils continuent la politique des dynasties précédentes, s'efforçant de rétablir à leur profit l'unité de l'Afrique du Nord : ils conquièrent Tunis en 1347. Mais le monde a changé : l'Europe s'ouvre aux influences nouvelles, se lance dans les grands voyages de découvertes, et les premières tentatives ibériques au Maroc, prolongements de la Reconquête, opérations commerciales ou de police, conduisent les Portugais à Ceuta en 1415.
Maintien de l'indépendance face aux Européens (XVIe-XVIIIe s.)
La civilisation marocaine peut continuer de briller, mais déjà la menace sur l'indépendance du pays se précise. Tout le XVe siècle et le début du XVIe sont marqués par des tentatives ibériques. Les Portugais s'emparent de Tanger en 1471 puis occupent Safi, Azemmour, Mazagan, Agadir, poussant des incursions dans l'intérieur ; en 1497 les Espagnols s'établissent à Melilla. La crise politique marocaine, marquée par la rivalité des grandes familles et par leur influence sur des souverains faibles, par les luttes de succession et par l'influence croissante des tribus, s'accompagne d'une grave crise économique née de la concurrence de nouveaux courants commerciaux utilisant les routes maritimes et les voies sahariennes orientales. Les difficultés, l'opposition à une occupation étrangère désormais étendue à tous les ports, de Melilla à Santa Cruz, suscitent le revif religieux. Ample mouvement de foi qui développe le culte des saints (maraboutisme), multiplie les confréries, il aura d'importantes conséquences sur l'avenir du pays en achevant son islamisation ; il renforça aussi les particularismes et fit évoluer le Maroc dans des voies opposées à celles qui commençaient de s'imposer en Europe.
La guerre sainte des Sa'diens (1523-1603)
Des confins « sauvages » du Sahara vont, une fois encore, surgir les forces nouvelles. Les Sa'diens, descendants du Prophète, venus d'Arabie au milieu du XIVe siècle, prennent, à la demande des gens du Drā, la tête de la guerre sainte. Entre 1510 et 1523, ils s'imposent dans le sud du pays. La reprise d'Agadir sur les Portugais, en 1541, premier coup d'arrêt à la pénétration européenne, leur vaut un immense prestige et leur facilite la conquête du Maroc.
La dynastie, maîtresse du pays en 1554, en reforge l'unité par la guerre sainte, qui a favorisé ses débuts. La victoire d'Alcácer-Quibir (Ksar-el-Kébir) sur les Portugais, en 1578, donne à Aḥmad al-Manṣūr (le Victorieux) prestige international et richesses – grâce à l'abondance des rançons des chevaliers chrétiens. Le nouveau souverain (1578-1603) s'oppose aussi aux Turcs, maîtres de la Tunisie et de l'Algérie. La conquête des oasis du Touat et du Gourara, les expéditions en direction du Soudan redonnent au Maroc, avec le contrôle du commerce saharien, les moyens financiers d'une forte réorganisation intérieure. L'administration centrale ( makhzen) est rénovée, l'armée développée, les cultures, comme celle de la canne à sucre, et l'artisanat sont encouragés. Le commerce avec l'Europe s'accroît et les grandes constructions se multiplient, à Marrakech en particulier.

L'œuvre, toutefois, n'est pas plus solide que celle des dynasties précédentes. Elle tient trop aux circonstances heureuses et à l'exceptionnelle personnalité du souverain. Aussitôt celui-ci disparu, les difficultés assaillent le Maroc : difficultés d'ordre économique du fait de la concurrence de nouvelles routes commerciales et de nouveaux fournisseurs de sucre, de la prospérité factice due à l'inflation des années 1590, faisant de ce siècle d'or le « reflet de l'or qui passe » ; d'ordre politique aussi, dues à la montée des forces des confréries et de leurs ambitions temporelles.
La piraterie accentue la rupture entre les différentes régions géographiques. Salé, favorisé par sa position et qui accueille les morisques d'Andalousie, après les grandes expulsions de 1609-1611, devient une petite république indépendante vivant des prises de bateaux et des rachats de prisonniers ainsi que du négoce qui en découle. Le particularisme et l'esprit régionaliste – une des constantes de l'histoire du Maroc – semblent à nouveau l'emporter. L'anarchie croissante favorise les pouvoirs locaux.
Les 'Alawītes
Les chérifs 'alawītes du Tafilelt n'étaient, au milieu du XVIIe siècle, qu'une modeste puissance, mais ils sont porteurs d'un grand nom, ils tiennent aussi un des axes du commerce saharien, encore important malgré sa relative décadence ; ils sont, enfin, portés par l'ambition et entraînés par les qualités de guerriers et d'organisateurs de leurs chefs, Mūlāy Maḥammad puis Mūlāy al-Rashīd (1664-1672). Maître du Maroc oriental, celui-ci entre à Fès en 1666, s'empare de Marrakech en 1669. Son frère et successeur, Mūlāy Ismā'īl (1672-1727), le plus célèbre des sultans du Maroc, consolide l'œuvre du fondateur de la dynastie et donne un nouvel éclat à la civilisation marocaine.
Sa principale tâche est de combattre les populations insoumises ou révoltées. Il crée une puissante armée à partir de nouveaux contingents de troupes noires ('abīds) et de l'ancien système des tribus militaires (gīshs). Elle lui permet de s'opposer aux empiètements des Turcs, de reprendre la plupart des places de l'Atlantique encore occupées par les Européens (Mehdia, 1681 ; Tanger, 1684 ; Larache, 1689). Politique coûteuse aux frais de laquelle ne suffisent pas les revenus décroissants de la course, étroitement contrôlée par le sultan, ni les droits prélevés sur un commerce extérieur que gêne une réglementation minutieuse. D'ailleurs elle se complique de difficultés diplomatiques avec les principales puissances : le sultan rompt avec la France et l'Espagne en 1718.

La crise financière suscite, dès la mort du sultan, des révoltes militaires. Une longue période de révolutions et de troubles paralyse le pays jusqu'en 1757. À l'agitation de l'armée s'ajoutent les poussées des tribus montagnardes vers les plaines voisines, les difficultés économiques, les famines qui déciment la population. C'est le début d'un long déclin que ralentit plus qu'il ne l'arrête le redressement opéré sous le long règne de Sīdī Muḥammad ben 'Abd Allāh (1757-1790). La forte reprise du négoce avec l'Europe (fondation d'Essaouira en 1765, traités de commerce), la réoccupation de Mazagan (1769) n'empêchent ni la décadence économique, marquée après 1787 par l'abandon de la frappe de l'or, ni les rébellions, ni le développement des pouvoirs féodaux que les crises de succession ont favorisées. Le pays tend à se replier sur lui-même. La disparition de la course, les entraves mises aux relations avec l'étranger, la forte dépopulation provoquée par les terribles épidémies de 1798-1800 et de 1818-1820, le ralentissement du commerce européen pendant les guerres de l'Empire, la relégation des agents diplomatiques à Tanger, tout contribue, au début du xixe siècle, à un isolement non seulement accepté mais explicitement voulu par le sultan Mūlāy Slimān (1792-1822).
La pénétration européenne (XIXe-XXe s.)
Face à ce déclin et à ce repli s'affirme le dynamisme nouveau de l'Europe industrielle, entraînée dans un mouvement général d'expansion qui la pousse à instaurer partout le libéralisme commercial, puis le système colonial. L'histoire du Maroc subit, désormais, de façon croissante, les pressions extérieures.
Le royaume en difficulté (1822-1912)
Le Maroc ne peut en effet rester longtemps à l'écart au moment où les routes méditerranéennes prennent, au milieu du XIXe siècle, une importance nouvelle. Les efforts de pénétration des commerçants britanniques de Manchester et de Gibraltar débouchent, en 1856, sur un traité de commerce, qui ouvre le pays aux produits européens. En 1863, une convention franco-marocaine aggrave encore la situation du Maroc. L'Espagne, à partir des présides conservés sur la côte rifaine, Ceuta et Melilla, reprend une politique d'expansion par la guerre de 1859-1860 et obtient, lors du traité de 1861, une importante indemnité de guerre et la rétrocession de l'ancienne possession de Santa Cruz Pequeña. Ainsi, en moins de sept ans, de décembre 1856 à 1863, ont été modifiés du tout au tout les rapports traditionnels entre le Maroc et l'Europe.
La rivalité des trois puissances se nourrit d'ambitions différentes : commerciales et stratégiques pour la Grande-Bretagne, préoccupée de la sécurité du détroit de Gibraltar ; politiques et sentimentales pour l'Espagne qui retrouve les souvenirs de la Reconquista ; économiques et territoriales pour la France désirant créer un ensemble nord-africain homogène, sous son autorité. Leur opposition, si elle sauvegarda le statu quo politique du Maroc, accentua une pénétration économique à laquelle l'Allemagne participa, à partir des années 1885-1890. Malgré les difficultés, les échanges, et en premier lieu les importations, s'accroissent fortement dans la seconde moitié du siècle. Cet essor, le développement des colonies européennes dans les ports, passées de quelques centaines d'individus à plus de quinze mille, l'extension de la protection, l'invasion des produits étrangers altérèrent gravement les structures traditionnelles de l'économie et de la société, provoquant de multiples crises.
Moūlāy Ḥasan (1873-1894), l'un des plus grands sultans de l'histoire marocaine, s'efforça prudemment de moderniser le pays, sans tomber sous l'influence dominante d'une puissance ; d'opposer les unes aux autres les rivalités, sans concessions majeures ; d'affirmer, au prix de coûteuses expéditions militaires, l'intangibilité des limites du Maroc contre les tentatives d'installation dans le sud du pays.
Il ne put que retarder l'échéance. L'avènement d'un successeur jeune et faible, l'entente, surtout, en 1904, de la France et de l'Angleterre, dont l'opposition avait constitué la principale sauvegarde du Maroc indépendant, précipitèrent la crise. L'affaiblissement du pouvoir central, la pénétration européenne, la remise en question des formes traditionnelles de la vie provoquèrent des oppositions et l'apparition de prétendants. Des tribus entrèrent en dissidence, ce qui accrut l'impécuniosité de l'État et le contraignit à l'emprunt (1904).
Cependant, le gouvernement français, assuré de l'appui des Anglais et s'étant acquis, par des accords analogues, celui de l'Espagne et de l'Italie, poursuivit, malgré l'opposition allemande, son dessein. La conférence d'Algésiras (avr. 1906) plaça le Maroc sous une sorte de protectorat de puissances, mais laissa à la France une influence prépondérante qu'elle affirma en débarquant, en août 1907, à Casablanca.

La pénétration française fut coupée de crises internationales provoquées par l'Allemagne qui cherchait, à travers le problème marocain, à ruiner l'entente franco-anglaise : affaire des déserteurs de 1908 ; « coup d'Agadir » de juillet 1911. Entravée par la résistance des tribus, elle conduisit cependant le sultan à accepter un traité de protectorat (30 mars 1912).
Dans le régime du protectorat (1912-1930)
Le régime du protectorat est hypothéqué par les engagements internationaux, comme l'acte d'Algésiras qui, imposant le système de la porte ouverte, interdisait toute mesure de protection douanière, et par d'autres accords signés par la France, qui divisaient le pays en trois parties administrées différemment. À l'Espagne fut confiée, le 27 novembre 1912, une zone d'influence au nord (Rif) et au sud (Tarfaya, Ifni). Le statut définitif de Tanger, sous contrôle international, fut réglé en 1923 par la convention de Paris.
Pendant quatorze ans, le protectorat s'incarna dans la forte personnalité de Lyautey, premier résident général (1912-1925). Il fit œuvre de conquête, d'organisation, de mise en valeur. Le ralliement des tribus, au nom du sultan, s'obtint en usant de diplomatie à l'égard des grands caïds ou en effectuant des opérations militaires. Les institutions laissèrent subsister le makhzen central et les anciens pouvoirs locaux complétés et contrôlés par une administration nouvelle. L'action économique, à l'aide d'importants capitaux privés, pour une grande part contrôlés par la Banque de Paris et des Pays-Bas, mettait en place un vaste équipement, cependant que la colonisation rurale se développait : ainsi, 57 000 hectares de lots officiels furent distribués et près de 200 000 hectares achetés par des particuliers en 1922, tandis que s'accroissait le nombre des Européens (40 000 immigrants de 1919 à 1922).

Mais l'essor économique, s'il entraînait le pays dans les voies nouvelles, n'était pas sans causer de graves déséquilibres qui rapidement se traduisaient par des mouvements sociaux et politiques. L'opposition de la domination européenne allait provoquer la révolte des masses paysannes (révolte d' Abd el-Krim, 1921-1926), relayées à partir des années trente par les nouvelles élites urbaines, avant que n'entrent en scène, après la Seconde Guerre mondiale, les masses ouvrières.
Abd el-Krim sut exploiter l'opposition à la domination européenne et le mécontentement des populations rifaines ; la République des tribus confédérées du Rif mit un moment en péril le protectorat. La reddition d'Abd el-Krim en 1926, comme le retrait de Lyautey, ouvrit une nouvelle période où la France recourut de plus en plus à l'administration directe, accéléra la colonisation rurale (en 1935, 840 000 ha, dont 271 000 ha de lots officiels), encouragea le peuplement européen et reprit la conquête militaire, achevée en 1944. Les effets de la crise économique mondiale, qui fut sensible au Maroc en 1931-1932, des maladresses administratives, comme le dahir (arabe, ẓahīr, loi) sur la juridiction berbère de mai 1930, la poussée démographique et ses premières conséquences sociales provoquèrent les premiers symptômes d'une nouvelle opposition. Celle-ci ne vint plus de la montagne et des forces traditionnelles, mais des jeunes élites modernes.
Renouveau du nationalisme
Ce mouvement nationaliste urbain, influencé aussi par les doctrines réformistes et panarabes qui agitaient l'Islam, prit forme en 1930. Le premier parti politique marocain, sous le nom de Comité d'action marocaine, animé par Allal el- Fassi, Ouazzani et Balafrej, élabora un « plan de réformes » qui, sans remettre en cause le principe du protectorat, s'en prit à ses déviations et à l'administration directe.
L'ère de libéralisme politique qu'ouvrait, en 1936, l'avènement du Front populaire en France encouragea les espoirs. Le mouvement gagnait les villes et les campagnes. Les troubles de 1937, à Meknès et Marrakech, montrèrent son extension. Pourtant, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les divisions du parti nationaliste, la crainte des revendications des pays de l'Axe rapprochèrent Français et Marocains.
Au lendemain du conflit, la situation avait considérablement changé. Les difficultés alimentaires, montrant la fragilité de l'économie du pays, avaient provoqué une grande misère et une forte émigration rurale. Le système colonial avait partout été ébranlé, la Charte de l'Atlantique avait rappelé le « droit de tous les peuples à choisir la forme de gouvernement sous lequel ils veulent vivre ». Le débarquement américain de novembre 1942, l'entrevue d'Anfa de 1943 où le sultan rencontra Roosevelt, les encouragements du président des États-Unis au nationalisme marocain précisèrent les revendications des partis politiques. L'influence de la Ligue arabe, la caution donnée au mouvement nationaliste par le sultan (discours de Tanger, 1947) rendaient urgente une nouvelle définition du régime du protectorat.
Des négociations s'engagèrent entre le sultan Sidi Mohammed et le gouvernement français, mais elles achoppèrent sur la question de souveraineté. À la fête du Trône, qui coïncidait en 1952 avec le vingt-cinquième anniversaire de son avènement, le sultan réaffirma sa volonté d'indépendance, cependant que les sanglants événements de Casablanca, les 7 et 8 décembre, annonçaient la crise. La résidence interdit le Parti communiste et le parti de l'Istiqlāl (indépendance), encouragea l'opposition au sultan de certains milieux traditionalistes (pétition du 21 mai 1953). Le 20 août, Sidi Mohammed fut contraint d'abdiquer. Il fut remplacé, le 21, par son cousin Ben Arafa. Le gouvernement français avait laissé faire : sa politique marocaine s'élaborait moins à Paris que dans les cercles liés à la résidence.
Les réformes qui devaient justifier le coup de force furent remises de mois en mois devant l'opposition conservatrice, puis le développement du mouvement de résistance marocain. Aux difficultés intérieures s'ajoutaient les difficultés extérieures. L'Espagne appuyait l'opposition marocaine. Les États arabes et asiatiques apportaient, aux Nations unies, leur soutien au mouvement nationaliste. Les revers d'Indochine (mai 1954), l'insurrection algérienne (1er nov. 1954) contraignirent le gouvernement français à s'orienter vers une solution politique.
L'indépendance
Après la recherche laborieuse d'un compromis, la déclaration de La Celle-Saint-Cloud, le 6 novembre 1955, annonce des « négociations destinées à faire accéder le Maroc au statut d'État indépendant uni à la France par des liens permanents d'une interdépendance librement consentie et définie ». Les négociations furent rapidement menées et aboutirent, le 2 mars 1956, à un accord qui considérait comme caduc le traité de Fès du 30 mars 1912 et reconnaissait l'indépendance du Maroc.
L'Espagne dut aligner son attitude sur celle de la France et mit fin à son pouvoir sur la zone nord (déclaration commune de Madrid, 6 avril 1956, accord du 7 avril 1956). Le sort de Tanger, enfin, fut réglé par la Conférence qui se tint à Fedala du 8 au 29 octobre 1956. Le Maroc était, à la fin de 1956, redevenu indépendant et unifié.
De multiples tâches attendaient le « nouvel » État. Il lui fallait se dégager des influences administratives étrangères, rallier une fraction réticente de l'armée de libération, créer des institutions. Il lui fallait aussi retrouver le sens de son évolution historique.
La lutte pour l'indépendance semblait se poursuivre par la reconquête d'un passé qui paraissait avoir été doublement confisqué : d'une part dans sa gestion, d'autre part dans son écriture dont on supposait qu'elle avait été systématiquement déformée par la vision « coloniale ». La redécouverte de leur passé par les Marocains et le renouvellement de l'historiographie dominent ainsi la vie culturelle du Maroc depuis les années 1960.
De l'indépendance du Maroc à Mohammed 6 (1956-1999)
L'indépendance marocaine est proclamée en 1956, mettant fin à quarante-quatre ans de protectorat français et espagnol. Du retour au pays du sultan Mohammed ben Youssef en novembre 1955 à l'accession au trône de Mohammed VI en 1999, les institutions du régime moderne s'organisent autour d'une formule monarchique singulière. Jouant des divisions entre les mouvements d'opposition, le palais s'impose comme un arbitre au-dessus de la mêlée face aux crises successives. À coup de répressions et de cooptations, forte du soutien d'une vaste clientèle, la monarchie prend progressivement l'initiative politique, étend son emprise sur l'économie du royaume et son contrôle du champ religieux.
Le règne de Mohammed V : l'épreuve de force entre le Palais et l'Istiqlal (1956-1961)
Le quinquennat de Mohammed V est le théâtre d'un bras de fer entre les deux forces issues du mouvement national : d'un côté, le sultan « martyr » bénéficiant d'une forte popularité et de l'autre, le parti nationaliste de l'Istiqlal (littéralement « l'indépendance »), auréolé de son combat politique et armé.
Le 7 mars 1956, le sultan prononce le discours par lequel le Maroc accède à l'indépendance à la suite de la signature de la convention franco-marocaine qui abroge le traité de Fès (1912) ; puis, l'accord hispano-marocain du 7 avril 1956 qui met fin au protectorat espagnol sur le nord du pays. Un bras de fer va rapidement se nouer pour le contrôle du régime qui se met en place.
D'un côté, le soutien apporté par le sultan à la lutte pour l'indépendance et son exil forcé à Madagascar en ont fait l'emblème du combat national. Il prend le titre de roi sous le nom de Mohammed V en 1957. De l'autre côté, le parti de l'Istiqlal peut envisager de se transformer en parti unique. Il rassemble de fait différents courants politiques, des plus tiers-mondistes aux plus bourgeois et conservateurs.
Les fondations du nouveau régime se dessinent dans ce contexte. Il s'agit d'affirmer l'unité de la nation. C'est pourquoi les Forces armées royales (FAR) sont créées en 1956 et placées sous le commandement du prince héritier, Moulay Hassan. Quant à l'Armée de libération nationale, bras armé de l'Istiqlal qui, au Sahara, continue à se battre contre les forces armées françaises et espagnoles, elle est finalement démantelée en 1958. Les FAR répriment dans la violence des insurrections populaires dans le Rif et le Moyen Atlas (1956-1958) qui sont menées contre les politiques de marginalisation de ces régions rurales et berbères. Cet épisode sanglant est profondément marqué dans la mémoire des Rifains. Il est à l'origine de la fondation, en 1959, du Mouvement populaire, un parti berbériste.
Par ailleurs, en privilégiant d'emblée une formule politique pluraliste plutôt qu'un système de parti unique (interdit par la Charte des libertés publiques promulguée en 1958), le souverain parvient à mettre en place les conditions d'un jeu politique concurrentiel, d'un « pluralisme autoritaire » dont il se fait l'arbitre. Certes, l'Istiqlal étend son réseau de partisans à l'échelle du royaume, y compris par le biais du puissant mouvement syndical de l'Union marocaine du travail (UMT), créée en 1955 sous la direction de Mahjoub ben Seddik. Mais rapidement le parti de l'Istiqlal connaît des divisions internes qui inaugurent, dans le Maroc contemporain, une histoire partisane faite de scissions régulières. La rupture entre la direction conservatrice de l'Istiqlal (Mohammed Allal el-Fassi, Ahmed Balafrej ou encore Mohamed Boucetta) et son aile gauche et syndicale est consommée dès 1959. Le 6 novembre 1959, l'Union nationale des forces populaires (UNFP) est fondée sous la direction de Mohamed Basri (dit le fiqh, le lettré), Mahjoub ben Seddik, al-Mahdi ben Barka, Abderrahim Bouabid ou encore Abdallah Ibrahim. L'UMT suit le nouveau parti, tandis que l'Istiqlal fonde sa propre centrale syndicale, l'Union générale des travailleurs du Maroc.
Abdallah Ibrahim prend la direction de l'UNFP Il dirige un gouvernement de 1958 à 1960, dont le programme s'inspire des projets tiers-mondistes de l'époque : son objectif de développement autocentré où le capital étranger jouerait un rôle marginal et le secteur public un rôle déterminant se heurte autant aux résistances du monarque qu'à celle des franges bourgeoises et conservatrices du mouvement national. En 1959 est créée la monnaie locale, le dirham, qui implique la sortie de la zone franc, ce qui inquiète les milieux d'affaires européens et marocains. L'économie du pays est également déstabilisée par le tremblement de terre d'Agadir de février 1960 qui fait 15 000 victimes.
En 1960, le roi Mohammed V démet le gouvernement. Il prend la présidence du Conseil, dans lequel l'Istiqlal accepte de jouer le rôle de force d'appoint, validant ainsi la prééminence du monarque au sein du régime. Fin stratège, Mohammed V a ainsi résisté aux velléités de l'Istiqlal de le cantonner à un rôle honorifique et s'impose comme le « représentant suprême de la nation » et le « commandeur des croyants » (amir al-mu'minin). Ainsi, cinq années de participation à l'exercice du pouvoir auront suffi à effriter la fragile unité du mouvement national.
C'est dans ce contexte que s'organisent les premières élections du Maroc indépendant. Le scrutin communal de mai 1960 est remporté par l'Istiqlal et l'UNFP. Mais il inaugure déjà le savoir-faire électoral du Palais. En effet, celui-ci s'appuie sur les notables locaux, soucieux de préserver leurs terres et leur statut (« Le fellah défenseur du trône », selon R. Leveau) et mobilise un réseau de clientèle pour faire face aux forces politiques concurrentes, plutôt urbaines, intellectuelles ou prolétaires.
Mohammed V décède brutalement le 26 février 1961. Son fils ainé, Moulay Hassan, désigné prince héritier depuis juillet 1957 et associé de près aux activités politiques de son père, accède au trône à l'âge de trente et un ans sous le nom d'Hassan II.
Le règne d'Hassan II : monarchie constitutionnelle
Le règne d'Hassan II (1961-1999) commence par l'adoption d'une Constitution qui marque l'emprise du monarque sur la société (1962). Le jeune roi étend son assise locale via le développement d'un maillage administratif serré et d'une ingénierie électorale qui s'affine de scrutin en scrutin. Toutefois, plusieurs coups d'État militaires perpétrés pendant les années 1970 mettent la monarchie en péril. Face aux oppositions de gauche et à divers mouvements sociaux, le Palais met en œuvre une répression qui plonge le pays dans des « années de plomb ». L'état d'urgence est proclamé, le Parlement est suspendu (1965-1970) et la violence d'État s'exacerbe. De la guerre des sables (1963) à la marche verte (1975), Hassan II s'impose néanmoins comme le garant de l'intégrité territoriale et comme l'incarnation d'une union sacrée qui contribue à une normalisation progressive de ses relations avec son opposition historique.
Opposition à sa majesté, opposition de sa majesté ?
Les premières années de règne d'Hassan II sont marquées par l'institutionnalisation d'une formule constitutionnelle taillée à la mesure du monarque. À la suite de Mohammed V, Hassan II demeure à la tête d'un cabinet d'union nationale qui exclut l'UNFP Ahmed Reda Guédira, l'un de ses proches conseillers, devient directeur du Cabinet royal, une instance qui prend rapidement une place déterminante au sein de l'exécutif marocain. Guédira occupe également les fonctions centrales de ministre de l'Intérieur et de l'Agriculture. Il fonde en 1963 le Front de défense des institutions constitutionnelles (FDIC). Créée dans le giron du Palais, cette organisation bénéficie du soutien de l'administration contre l'opposition de gauche, et rassemble autant les notables ruraux que des représentants de la bourgeoisie urbaine, de la haute administration ou des nouvelles professions libérales. Cette formation est qualifiée au Maroc de parti d'administration (ce sera également le cas du Rassemblement national indépendant, fondé en 1979 par Ahmed Osman, Premier ministre et beau-frère du roi).
En décembre 1962, la première Constitution marocaine est adoptée par référendum. Soutenu par l'Istiqlal, le Mouvement populaire et les Indépendants, le scrutin est boycotté par l'UNFP, l'UMT, et le Parti communiste marocain (P.C.M., clandestin depuis 1960). Le texte fondamental, rédigé au Palais, institutionnalise le roi comme « Commandeur des croyants » (art. 19). Le principe de séparation des pouvoirs est entamé par le fait que le monarque délègue ses pouvoirs aux différentes institutions. Hassan II impose le recours à la consultation populaire, et non à une Assemblée constituante, comme le revendique l'opposition, ce qui lui permet d'asseoir son pouvoir sur le même principe de légitimité que celui de ses adversaires : le suffrage populaire. En remportant une adhésion importante à son projet de Constitution avec 80 % des voix, le monarque apparaît comme le représentant privilégié du peuple sans prendre parti pour tel ou tel groupe politique.
Dans la foulée, en mai 1963, les premières élections législatives sont organisées. Deux coalitions s'affrontent : la première, la coalition « monarchique » est menée par le FDIC de Guédira et le Mouvement populaire (berbère), la seconde par l'UNFP et l'Istiqlal qui a quitté le gouvernement. L'issue du scrutin est partagée, le pays renvoyant dos à dos les deux adversaires. Si le Mouvement national ne refait pas les mêmes scores qu'en 1960, les résultats sont toutefois un camouflet pour le gouvernement. Malgré un soutien appuyé de l'administration, notamment dans les circonscriptions rurales, la coalition monarchiste se révèle faiblement majoritaire au Parlement (elle ne peut s'imposer qu'avec le soutien d'une poignée d'indépendants).
Au lendemain du scrutin, alors que la campagne pour les élections communales s'organise, un nouveau rapport de force éclate entre le Palais et l' opposition. Certains journaux de l'opposition (Al-Alam, La Nation africaine et Al-Tahrir) font l'objet de poursuites. Des membres de l'Istiqlal puis de l'UNFP et du P.C.M. sont arrêtés et inculpés, en juin 1963, pour atteinte à la sécurité de l'État puis, en juillet 1963, pour complot contre le régime. La monarchie décide de porter un coup à l'UNFP en particulier, en raflant ses militants. Nombre d'entre eux sont incarcérés ou disparaissent. Malgré les consignes d'abstention de l'opposition, la consultation électorale communale a lieu à la fin de juillet 1963. Les élections sont remportées par le FDIC Pour parachever la mise en place des nouvelles institutions de la monarchie constitutionnelle naissante, les Assemblées provinciales sont élues, en octobre 1963, au suffrage indirect, confortant ainsi l'alliance entre le Trône et les élites rurales.
À la même période, un grave différend naît entre le Maroc et l'Algérie au sujet de leurs frontières sahariennes : la « guerre des sables » se déroule du 14 octobre au 2 novembre 1963. Cet affrontement armé atténue un temps l'activité protestataire de l'opposition et conforte la puissance des FAR, colonne vertébrale du régime. Toutefois, Ben Barka, « commis-voyageur de la révolution » (selon l'historien Jean Lacouture) s'exile en 1963 afin de poursuivre l'objectif de fédérer le courant tiers-mondiste. Il est condamné à mort par contumace dans son pays avec d'autres opposants nationalistes tels que Mohammed Basri, Cheikh al-Arab, Hamid Berrada, Mohamed Bensaïd Aït Idder, lesquels fuient via l'Algérie. De novembre 1963 à mars 1964, plus de deux cents procès de personnes arrêtées pour complot sont organisés.
Les « années de plomb »
L'étau se resserre autour des opposants et, en particulier, des mouvements de gauche. La répression s'intensifie : des mouvements lycéens et étudiants à Casablanca, puis à Fès et à Rabat, tournent au soulèvement populaire le 23 mars 1965. Rejoints par leurs familles, soutenus par l'Union nationale des étudiants marocains (UNEM) et le syndicat des enseignants au sein de l'UMT, ils protestent contre une circulaire limitant l'âge d'entrée dans le second cycle. Puis le mouvement s'élargit aux jeunes des quartiers populaires, aux chômeurs et aux ouvriers qui s'insurgent contre leurs conditions de vie et l'impossible mobilité sociale. La réaction des forces de l'ordre, menée par Mohammed Oufkir, ministre de l'Intérieur et général des FAR, est violente. Non seulement le nombre de morts est important (plusieurs centaines), mais une série de procès s'ensuit. Cet épisode reste emblématique dans la mémoire de la gauche marocaine : il donnera son nom au « groupe du 23-Mars », une organisation marxiste-léniniste fondée en 1968 qui, avec le mouvement Ila al-amam (« en avant ») de Abraham Serfaty et du poète Abdellatif Laâbi, prennent la direction de l'UNEM en 1969. Il inaugure en outre un cycle d'insurrections urbaines qui vont rythmer la vie politique marocaine et motiver la mise en œuvre d'une politique d'urbanisme sécuritaire.
Le 7 juin 1965, le roi déclare l'état d'exception dans le pays. Le Parlement est dissous. En octobre 1965 éclate « l'affaire Ben Barka » : le chef de file de l'opposition marocaine est enlevé (son corps ne sera jamais retrouvé) devant la brasserie Lipp à Paris.
Les « années de plomb » (procès, enlèvements, tortures, disparitions, etc.) s'inscrivent dans une exacerbation des rapports de forces entre la monarchie et ses oppositions. Durant cinq ans, Hassan II détient des pouvoirs exceptionnels. Ce n'est qu'en juillet 1970 que la Constitution est révisée puis soumise à référendum, et qu'un nouveau Parlement est élu. Le Palais doit affronter une déstabilisation sérieuse, au sein de ses propres troupes, avec deux tentatives de coups d'État : l'attaque du palais de Skhirat en 1971 et l'attentat contre le Boeing royal en 1972. De hauts gradés de l'état-major sont impliqués, notamment le général Oufkir, commandant en chef des FAR, ministre de l'Intérieur puis de la Défense. L'appareil sécuritaire du royaume est alors décapité. Les principaux responsables sont exécutés, et le bagne de Tazmamart accueille les autres mutins, voire les familles de ceux-ci (notamment celle du général Oufkir). Hassan II proclame à nouveau l'état d'exception.
En mars 1973, une autre menace pour le Palais fragilise le régime alors qu'éclate une insurrection dans le Moyen-Atlas. Celle-ci est qualifiée de « complot du 3 mars » par les autorités. Certains y voient une escalade dans la lutte armée contre la monarchie, nourrie par les velléités de guérillas fomentées par l'opposition en exil en Algérie. D'autres estiment qu'il s'agit d'une manipulation de la monarchie pour augmenter la répression et les arrestations et affaiblir davantage l'UNFP.µ
Les années 1970 sont donc le creuset du développement d'oppositions radicales, qui remettent en cause la légitimité de la monarchie : celle du mouvement marxiste-léniniste et celle des mouvements islamistes. Ces mouvements s'affrontent également entre eux, en particulier sur les campus (assassinat, en 1977, d'Omar Benjelloun, leader de l'UNEM, par un militant de la Jeunesse islamique).
Le mouvement marxiste-léniniste marocain se nourrit de l'effervescence estudiantine marocaine et européenne de l'époque (Mai 1968). Derrière un front commun, il prend le pouvoir à l'UNEM en 1969, se considérant à « l'avant-garde des masses populaires ». Il défend le droit à l'autodétermination des populations sahariennes et appelle à l'émancipation des peuples. Le Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de Oro dit Front Polisario est créé en mai 1973 pour lutter et chasser l'occupant espagnol. L'UNEM est dissoute de 1973 à 1978. Ses leaders et militants sont arrêtés à plusieurs reprises et de grands procès sont organisés. À l'instar d'Abraham Serfaty, incarcéré de 1977 à 1991, ces prisonniers politiques deviennent les victimes emblématiques du régime répressif.
Ces mêmes années voient le développement d'une opposition islamiste, incarnée d'abord par Abdessalam Yassine (dit Cheikh Yassine). Dans une lettre ouverte adressée au souverain (« l'islam ou le déluge »), il dénonce l'impiété du régime et dénie au roi sa qualité de « Commandeur des croyants ». Il fonde, en 1973, le mouvement Justice et bienfaisance (al-adl wa al-ihsan), une organisation interdite, tour à tour réprimée et tolérée. Cheikh Yassine est arrêté en 1974 puis interné en hôpital psychiatrique jusqu'en 1979. D'autres mouvements politiques dissidents se développent, notamment dans les universités, autour d'une idéologie islamique, à l'exemple de la Jeunesse islamique. Si sa branche armée sera poursuivie, sa branche réformiste (Jamaa islamiya) est le terreau du développement d'associations politiques ou caritatives à partir des années 1980.
Ces « années de plomb » sont dominées par le rôle joué par l'armée, par les deux ministres de l'Intérieur : le général Oufkir et, à partir de 1979, Driss Basri, par la Direction générale des études et de la documentation et la Direction de la surveillance du territoire, les deux principaux services de renseignement et de contre-espionnage du pays.
La « marche verte » et le développement économique : vers l'apaisement ?
C'est finalement une menace extérieure qui donne à la monarchie l'opportunité de remobiliser la société divisée derrière une « union sacrée ». Le Sahara marocain est un territoire désertique de 266 000 kilomètres carrés aux confins de la Mauritanie et de l'Algérie, toujours sous occupation espagnole en 1973. Le Mouvement national marocain le réclame de longue date. En 1975, l'Espagne annonce l'organisation d'un référendum sur l'autonomie interne du Sahara. Hassan II prononce alors un discours célèbre, le 16 octobre 1975, appelant le peuple marocain à une marche verte pacifique et populaire pour la « libération territoriale du Maroc ». Une large partie de l'opposition se range derrière cette cause nationale. La marche débute en novembre 1975, elle est composée de 350 000 volontaires encadrés par les FAR. L'armée espagnole ne lui fait pas barrage, et l'initiative de Hassan II est un succès : le 14 novembre 1975, à Madrid, l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie signent un accord consacrant le partage de ce territoire entre Rabat et Nouakchott. Les FAR s'installent dans la ville de Laayoune. En réaction, le Front Polisario, basé à Tindouf et soutenu par l'Algérie, proclame en 1976 la République arabe sahraouie démocratique. Débute alors un conflit entre le Maroc, le Front Polisario, la Mauritanie et l'Algérie.
Durant cette période, le régime bénéficie également d'une conjoncture économique favorable qui lui permet de rassurer les classes moyennes et les milieux d'affaires : la politique de marocanisation de 1973, « ni étatisation, ni nationalisation », et le plan quinquennal de 1973-1977 sont des pivots institutionnels de ce dispositif. La monarchie met un frein important à l'investissement étranger, en obligeant les nombreuses sociétés étrangères opérant sur le territoire marocain à céder 50 % de leur capital ainsi que le poste de président-directeur général à des personnes de nationalité marocaine. Par le biais de nationalisations et de prises de monopole dans certains secteurs, l'État dispose des principaux moyens de production. Le développement du secteur public repose sur la production des phosphates qui, par le biais de l'Office chérifien des phosphates, assure une rente conséquente au Maroc durant les années 1970 lorsque les cours du minerai s'envolent. Cette manne permet de créer de nouveaux holdings tels que la Société nationale d'investissement ou la Caisse des dépôts et de gestion. Alors que les entreprises publiques se développent dans les secteurs clés de l'économie du royaume, de grands groupes privés prennent aussi leur envol, souvent dans le giron de ce secteur public, et en étroite connivence avec les intérêts des dirigeants du pays. C'est le cas de l'Omnium nord-africain (ONA). Ce groupe, constitué sous le protectorat, s'est développé dans les premières années de l'indépendance grâce à une série de rachats qui permet à la holding de la famille royale, Siger-Ergis (anagrammes de « regis », le roi), d'en être le principal actionnaire. L'ONA devient le premier groupe industriel et financier privé du royaume et la cheville maîtresse du patrimoine personnel du souverain, lequel place des proches à sa tête.
Le règne d'Hassan II : libéralisations économiques et alternance politique
À partir des années 1980, le Maroc entre dans l'ère de la libéralisation économique, puis des privatisations et de l'ouverture de l'économie au marché international. Dans le même temps, la monarchie et son opposition préparent « l'alternance gouvernementale » qui aura lieu en 1998 avec la nomination d'un Premier ministre issu du parti d'opposition de Ben Barka.
L'ajustement structurel et les privatisations
Le Maroc s'endette rapidement avec la chute des prix du phosphate à partir de 1976. Par ailleurs, la guerre menée au Sahara marocain contre le Front Polisario est coûteuse. Enfin, les disparités sociales s'accentuent : le monde rural est touché par une crise agricole liée à un cycle de sécheresse et le monde urbain par l'explosion démographique, des difficultés dans le secteur industriel et le développement des bidonvilles. En 1981, d'importants mouvements, voire des émeutes, embrasent le pays, à la suite de l'annonce de l'augmentation des prix de produits de première nécessité subventionnés. La répression fait de nombreuses victimes. Elle est dirigée par Driss Basri, ministre de l'Intérieur de 1979 à 1999, qui joue un rôle central dans l'étau sécuritaire et le maillage territorial. D'autres soulèvements, appelés « émeutes de la faim », font à nouveau un grand nombre de victimes en 1984 et sont encore l'occasion d'arrestations dans les rangs de l'opposition.
Quoi qu'il en soit, figurant parmi les quinze pays les plus endettés au monde dès la fin des années 1970, le royaume chérifien doit se plier à une thérapie de choc négociée avec la Banque mondiale et le FMI En 1983, un programme d'ajustement structurel est lancé ; il est un des premiers plans de ce type dans la région : restructuration des instruments d'intervention de l'État, réformes des finances publiques, de la politique monétaire et des cadres du commerce extérieur. Le Maroc adhère au GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) en 1987, le Parlement adopte une loi sur les privatisations des entreprises publiques en 1989, et des accords de partenariat en vue de l'établissement d'une zone de libre-échange sont signés avec l'Union européenne en 1996. Ces réformes économiques, très étroitement encadrées par l'administration, promettent l'avènement d'une classe moyenne d'entrepreneurs et le dégraissage d'un État jugé dépensier. Au final, ces opérations de transfert sont l'occasion pour l'administration centrale de se décharger d'une partie des dépenses de l'État au profit du secteur privé, notamment dans les domaines sociaux ou urbains, sans toutefois perdre le contrôle de la décision. Les privatisations contribuent à concentrer les capitaux et à densifier les relations d'interdépendances économique et politique : les opérations sont finalement fructueuses pour un nombre limité d'investisseurs nationaux ou internationaux.
Dans le monde des affaires, la privatisation se traduit par l'émergence négociée d'une nouvelle forme de syndicalisme patronal, représentée par la Confédération générale des entreprises marocaines. D'un club de patrons casablancais, celle-ci se transforme en organisation plus puissante, notamment à la faveur de la « campagne d'assainissement » menée par le ministère de l'Intérieur en 1996. En effet, le patronat commença à faire entendre sa voix face à la vague d'interpellations et de procès intentés contre des hommes d'affaires, des commerçants, des industriels, des élus locaux au nom de la « lutte contre la corruption ». Au tournant des années 1990, le champ politique semble s'ouvrir.
Alors que l'Union socialiste des forces populaires (USFP), séparée de l'UNFP depuis 1975, crée la Confédération démocratique des travailleurs (CDT) en 1978, le Palais et cette nouvelle opposition négocient un modus vivendi. Ce rapprochement a lieu dans le contexte des grandes manifestations qui agitent le royaume en 1990 contre la guerre du Golfe et en soutien au peuple irakien, qui donnent plus de visibilité à l'opposition islamiste. Alors qu'un cessez-le feu est annoncé au Sahara marocain en 1991, le Palais s'engage dans une reprise du dialogue avec ses opposants historiques et dans une sortie progressive des années de plomb.
La publication de plusieurs ouvrages au tournant des années 1990 contribue à mettre à l'ordre du jour la question des droits de l'homme, pour laquelle se battent de longue date des organisations militantes telles que la Ligue marocaine pour la défense des droits humains créée en 1972, l'Association marocaine des droits humains créée en 1979 ou l'Organisation marocaine des droits humains créée en 1988. Après avoir créé un Conseil consultatif des droits de l'homme en 1991, Hassan II fait un geste en ouvrant les portes du bagne de Tazmamart et en libérant des prisonniers politiques tels qu'Abraham Serfaty en 1991.
Après plusieurs tentatives d'accord avec l'opposition parlementaire, finalement, à l'issue d'une nouvelle réforme de la Constitution (1996) qui institue le bicaméralisme et l'organisation d'élections communales et législatives (1997), le Roi nomme, en 1998, à la tête du gouvernement Abderrahmane Youssoufi, opposant socialiste de longue date et secrétaire général de l'USFP.
Alors que les nouvelles oppositions se font entendre notamment dans l'arène islamiste, le Palais et son opposition historique entrent dans une nouvelle phase de collaboration. Après qu'Allah ait rappelé à lui SM le roi Hassan II le 23 juillet 1999, il laisse un royaume où les ennemis irréductibles d'hier, le puissant ministre de l'Intérieur Driss Basri et les représentants de l'USFP notamment, cohabitent désormais au sein d'un même gouvernement. Du côté de l'opposition islamiste, si la puissante association Justice et bienfaisance ne peut toujours pas se constituer en parti politique, en revanche, des héritiers de la Jamaa islamiya réunis au sein du Mouvement unité et réforme fondent en 1998 le Parti de la justice et du développement (PJD).
Ainsi, SM Mohammed VI accède au trône en 1999, alors que la monarchie constitutionnelle est forte d'institutions solides, mais est en butte à de nouvelles oppositions et à une problématique sociale qui s'aggrave.
Le Maroc depuis SM Mohammed VI
Le 30 juillet 1999, SM Mohammed VI monte sur le trône du royaume du Maroc, après le long règne de son père Feu SM Hassan II (1961-1999). Son avènement suscite l'espoir de voir le royaume ouvrir son espace politique et porter davantage attention à la justice sociale. Le nouveau monarque sera-t-il à la hauteur des défis que doit relever le pays ?
Le Maroc de Feu SM Hassan II, sous la houlette du ministre de l'Intérieur Driss Basri, a surmonté les menaces qui pesaient sur le régime (telles que les émeutes de Casablanca et dans le Rif en 1965, les coups d'État de 1971 et de 1972, les émeutes sociales des années 1980...) mais au prix de la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Trois mois après l'accession de SM Mohammed VI au pouvoir, Driss Basri, symbole des « années de plomb », est limogé. Ce geste symbolique laisse entrevoir la volonté du monarque de régénérer une monarchie décriée dans la presse internationale.
Au cours de la décennie 2000, alors que le Maroc est confronté à des mutations sociales, religieuses et économiques, SM Mohammed VI met en œuvre plusieurs réformes : celle du Code du travail en 2003 et celle du Code de la famille en 2004. Il crée également une instance Équité et Réconciliation (IER) chargée de faire la lumière sur les atteintes aux droits de l'homme commises sous le règne de Feu SM Hassan II. Il lance l'Initiative nationale pour le développement humain en 2005 afin de réduire la pauvreté et le chômage. Enfin, il organise la réforme de la Constitution en 2011, dans le contexte du « printemps arabe ». Toutefois, dans le même temps, le roi maintient un système qui engendre de profondes inégalités sociales et régionales.
Lors du « printemps arabe », le monarque annonce, dès le 9 mars 2011, des réformes constitutionnelles destinées à transférer des compétences à l'Assemblée nationale et au Premier ministre, lui permettant de désamorcer une situation politique très tendue en Afrique du Nord.
Début de règne et des espoirs
Les changements institutionnels sont peu visibles, bien qu'en septembre 2002 soient organisées les premières élections législatives non contrôlées par Driss Basri, à la suite desquelles Driss Jettou est nommé Premier ministre du nouveau gouvernement. Toutefois, SM Mohammed VI a, sur la scène internationale, considérablement amélioré l'image du Maroc par sa volonté de rompre avec le passé et de renouer avec la population. Seules les relations avec l'Espagne restent tendues et se détériorent en juillet 2002 lors d'un conflit de souveraineté sur l'îlot du Persil (à l'ouest de Ceuta). Madrid récupère l'îlot occupé par des soldats marocains, mais cet incident réveille les inquiétudes espagnoles quant aux revendications marocaines sur les villes de Ceuta et de Melilla.
Le 16 mai 2003, cinq attentats-suicides perpétrés à Casablanca provoquent la mort de quarante-cinq personnes (dont les quinze terroristes) et font une centaine de blessés. Ces attaques meurtrières sonnent le glas de l'ouverture politique. La logique sécuritaire au cœur de l'appareil d'État devient à nouveau prioritaire. En effet, fortement dépendant du tourisme, des investisseurs étrangers et de son image de havre de paix, le Maroc craint, avec ces attentats, de devenir la cible de groupes terroristes. Des arrestations massives sont opérées sur l'ensemble du territoire et les mesures antiterroristes se multiplient afin de rassurer tout le monde en prouvant que l'État marocain est toujours capable de contrôler le pays.
Des réformes sociales et une politique sécuritaire
Les attentats de 2003 surviennent alors que le Maroc voit la création, à l'initiative de SM Mohammed VI, en novembre 2003, de l'IER. Fondée sur le principe de la justice transitionnelle, l'IER a pour mission d'établir le bilan des violations des droits de l'homme, ainsi que celui de l'indépendance du pays après le départ de Feu SM Hassan (Allah y Rahmo) II afin de réconcilier les Marocains avec leur passé douloureux. SM Mohammed VI a accepté de tenir compte des recommandations émises par l'Association marocaine des droits de l'homme (vérité sur le destin des disparus, retour des dépouilles, octroi de certificats de décès aux familles, réhabilitation des victimes et réparation avec une indemnisation...). Le 30 novembre 2005, l'IER remet son rapport final au monarque. Alors que la création de l'instance a conforté les défenseurs des droits de l'homme, son bilan donne lieu à un constat mitigé, notamment lié au refus de l'État d'identifier les responsables des violations et de les juger. De plus, en contradiction avec les principes mêmes de l'IER, la lutte étatique engagée contre le terrorisme, à la suite des attentats de Casablanca en 2003, se traduit par de nouvelles violations massives des droits des accusés avec le recours à la torture.
Malgré les inquiétudes sécuritaires, le gouvernement met en œuvre une série de réformes visant à satisfaire des demandes sociales revendiquées de longue date. Ainsi, sous le gouvernement de Driss Jettou (2002-2007), une réforme du Code du travail, considérée comme une révolution sociale, est votée en juillet 2003. À la suite de négociations entre le gouvernement, les syndicats les plus importants et la Confédération générale des entreprises au Maroc, le nouveau Code du travail favorise la représentation syndicale au sein des entreprises, redéfinit le taux des indemnités légales de licenciement, réorganise le temps de travail et octroie une protection sociale aux travailleurs.:
Par ailleurs, en janvier 2004, un nouveau Code de la famille est adopté ; il redéfinit les relations au sein de la famille et notamment les relations homme-femme au sein du couple. Celle-ci est placée dorénavant sous la responsabilité des époux. Par ailleurs, la femme n'a plus besoin d'un tuteur pour se marier ; l'âge minimal légal pour le mariage des jeunes femmes est fixé à 18 ans (contre 15 ans auparavant) ; la garde des enfants revient d'abord à la mère. Si la polygamie est maintenue, elle est rendue plus difficile. Ce nouveau Code de la famille est une victoire pour les associations de défense des droits de la femme au Maroc qui militent depuis les années 1990 pour obtenir l'égalité juridique entre l'homme et la femme au sein de la famille.
La lutte contre la pauvreté et la précarité
Depuis 2003, le Maroc connaît une croissance économique soutenue, de l'ordre de 5 à 6 % par an, qui a permis de réduire le chômage de 22 à 15 %, sauf chez les jeunes (30 % en 2012). Le phénomène du chômage massif des jeunes au Maroc est sans aucun doute le défi le plus important à relever pour le gouvernement.
En juillet 2003, le ministère de l'Habitat lance un ambitieux programme « Villes sans bidonvilles », lequel cible quatre-vingt-cinq villes marocaines. Dix ans plus tard, deux cent quarante mille familles auraient profité du programme et quarante-trois villes sont déclarées « sans bidonvilles ».
Dans ce contexte, le 18 mai 2005, SM Mohammed VI lance l'Initiative nationale pour le développement humain, un projet de lutte contre la pauvreté et la précarité. Doté d'un budget de 10 milliards de dirhams sur cinq ans, ce programme a pour objectif d'offrir aux populations les plus démunies l'accès aux infrastructures élémentaires, comme l'eau, l'électricité et la santé. Dès le lancement, trois cent soixante communes rurales et deux cent cinquante quartiers urbains sont identifiés comme prioritaires.
Toutefois, d'importantes inégalités régionales subsistent. Ainsi, la région du Nord, qui avait été délaissée, est devenue une zone d'investissements et de développement importants, avec la construction du port Tanger-Med (2004-2007), l'implantation en 2012 d'une usine Renault à Tanger, la rénovation du centre-ville de Tanger, la construction à partir de 2011 d'une ligne TGV entre Tanger et Casablanca, la création de marinas... Si les villes moyennes du nord et de l'est continuent à être le théâtre de contestations politiques et sociales, force est de constater qu'elles font désormais l'objet, de la part des pouvoirs publics, d'une attention nouvelle.
Désenchantement de la population et raidissement politique
Tandis que 2007 est une année électorale, Casablanca est à nouveau le théâtre de trois vagues d'attentats-suicides les 11 mars, 10 avril puis 14 avril, provoquant la mort d'un policier en plus des sept terroristes. Le 13 août 2007, un attentat contre des touristes échoue à Meknès. Ainsi, lorsque le 3 novembre 2007, Ayman Al-Zawahiri, le numéro deux d'Al-Qaida, appelle les musulmans du Maghreb à proclamer le jihad, il confirme les inquiétudes des autorités marocaines.
C'est dans ce climat de violence et d'insécurité que se déroulent, le 7 septembre 2007, les élections législatives. L'Istiqlal, parti conservateur nationaliste historique, est le vainqueur sans surprise du scrutin. La peur des islamistes est fatale au Parti de la justice et du développement (PJD), qui est assimilé à la violence terroriste des islamistes de Casablanca. Les résultats de ce scrutin rassurent ceux qui doutaient de la capacité du nouveau monarque à contrôler les islamistes du PJD SM Mohammed VI démontre ainsi qu'il reste maître de l'agenda politique et impose sa volonté de régner et de gouverner en consolidant le régime de l'alternance contrôlée qui avait été instauré par Feu SM Hassan II.
La montée de la contestation sociale en 2011 : le Mouvement du 20-Février
Lorsque les révoltes en Tunisie puis en Égypte chassent du pouvoir leurs dirigeants en janvier et février 2011, les Marocains descendent dans la rue. Plusieurs centaines de milliers de jeunes se mobilisent, à partir de février 2011, dans plus de cinquante villes du royaume, grâce aux réseaux sociaux d'Internet. Dès lors, les nombreuses manifestations sont organisées par le Mouvement du 20-Février qui, rassemblant des militants islamistes du mouvement Justice et Bienfaisance (Al Adl-wa-al-Ihsan), des ONG laïques ou des cyberactivistes, réclame une réforme constitutionnelle ambitieuse. Le monarque ne cristallise pas sur sa personne le sentiment de rejet observé chez les manifestants des pays voisins. Aussi, le Mouvement du 20-Février ne recherche pas la confrontation avec la monarchie mais tente de faire reconnaître certaines doléances.
Afin d'endiguer ces contestations, SM Mohammed VI annonce le 9 mars 2011 la mise sur pied d'une commission consultative de révision de la Constitution. Le 17 juin 2011, lors d'une allocution télévisée, le roi annonce un projet de réforme constitutionnelle. Ce projet, officiellement adopté par référendum le 1er juillet 2011 à une très large majorité (98 % des voix), vise à transférer une partie des pouvoirs du roi vers le Premier ministre. Ce dernier est désormais désigné au sein du parti vainqueur des élections législatives et non plus nommé par le roi ; il devient également le seul dépositaire du pouvoir de dissolution des chambres.
Toutefois, le roi conserve un rôle exécutif très important : il préside le conseil ministériel, reste le chef des armées et le commandeur des croyants. SM le Roi Mohammed VI réussit à faire du Maroc une exception dans la région.
À la suite du « printemps arabe », des élections législatives anticipées sont organisées le 25 novembre 2011. Elles sont remportées par le PJD, loin devant l'Istiqlal. Le chef du parti vainqueur, Abdelilah Benkirane, est nommé au poste de Premier ministre par le roi, comme le stipule la nouvelle Constitution. Selon certains quotidiens, une « guerre froide » se serait installée entre le cabinet royal et le gouvernement islamiste. Si, pour certains, le PJD représente l'espoir d'une meilleure justice sociale, pour d'autres, il soulève des inquiétudes, notamment dans sa volonté de moraliser les mœurs. En fait, en ces temps de crise, les islamistes s'avèrent être les meilleurs alliés de la monarchie, dans la mesure où ils transfèrent les problèmes du champ politique à celui de la morale, réduisant ainsi à néant les revendications du Mouvement du 20-Février.
Le Maroc, le Sahara et l'intégration régionale
Une décennie après l'accession au trône de SM Mohammed VI, la question du Sahara demeure toujours en suspens.
Et pourtant, en mars 2005, la rencontre entre le président algérien Abdelaziz Bouteflika et SM le roi Mohammed VI semble constituer les prémisses d'un dégel. La presse rapporte la rumeur qui annonce la réouverture de la frontière entre l'Algérie et le Maroc comme un premier geste symbolique. Toutefois, l'enthousiasme est de courte durée. SM Mohammed VI annonce qu'il ne participera pas au sommet des chefs d'État de l'Union du Maghreb arabe (UMA), organisé les 25-26 mai 2005 par la Libye, provoquant de fait son annulation. Les propos du président algérien, tenus quelque temps auparavant, sur le droit à l' autodétermination des Sahraouis remettent en question les tentatives de réconciliation algéro-marocaines.
En mai 2012, Rabat réclame le départ de l'émissaire des Nations unies au Sahara occidental, Christopher Ross, à la suite de la présentation de son rapport final, très critique envers les autorités marocaines. En effet, celles-ci n'apprécient pas le rappel à la résolution 2204, adoptée en avril 2012, qui réaffirme l'autodétermination du peuple sahraoui, soutenue par le Front Polisario et l'Algérie, et proroge d'un an le mandat de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso). De plus, l'émissaire de l'ONU affirme être convaincu que la seule issue au conflit est l'autonomie des Sahraouis au sein du royaume.
Au cœur de la discorde entre l'Algérie et le Maroc, le Sahara demeure un problème sans solution qui paralyse toute initiative d'intégration régionale.
Cette tension permanente entre les deux grands pays exaspère les acteurs économiques de la région. Les échanges commerciaux intrarégionaux demeurent toujours aussi faibles, ils ne représentent que 5 % des échanges totaux des pays membres de l'UMA. Ceux-ci ont d'autant plus intérêt à porter le projet d'une intégration économique régionale que les dirigeants politiques semblent à nouveau entrer dans une période de « guerre froide ».
Ainsi, afin de compenser l'absence d'un marché régional, ils développent des relations économiques avec plusieurs partenaires. Rabat signe un accord de libre-échange avec la Turquie en 2004, met en place une zone de libre-échange avec les États-Unis en 2006, signe le traité d'Agadir en 2007 qui est un accord de libre-échange entre l'Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie. Par ailleurs, le 17 février 2007, « les patrons des patrons » de l'Afrique du Nord se réunissent à Marrakech et annoncent la naissance de l'Union maghrébine des employeurs.
En conclusion, après la Tunisie de Ben Ali, le royaume chérifien est devenu, pour l'Union européenne, le meilleur élève au sud de la Méditerranée. Les réformes engagées au cours de la décennie 2000 lui ont permis d'échapper à la violence des pays en transition dans la région.

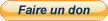
Commenti