HISTOIRE DES TERRITOIRES SAHARIENS
- 6 oct. 2024
- 20 min de lecture

Jusqu’à l’instauration du protectorat français sur le Maroc en 1912 ou la conclusion entre les puissances colonisatrices d’accords de partage de territoires pour l’exercice de leur influence, ont fait partie intégrante du Maroc, et sur lesquels ce dernier a exercé sa souveraineté.
Comment cette souveraineté a-t-elle été exercée et comment à la suite de la pénétration européenne ces territoires furent détachés ? Telles sont les questions qui aujourd’hui pourraient faire l’objet d’une étude de portée historique mais qui ne changeront rien aux données fondamentales historiques, géographiques, ni à la volonté de leurs populations, données qui sont déterminantes pour leur attachement au pays d’origine.
Tel est donc le cadre et telles sont les questions qui se posent en ce qui concerne le Maroc pour les territoires du Sud, Tindouf, Rio-de-Oro et la Mauritanie (dont la frontière naturelle avec le Sénégal est le fleuve Sénégal), et pour les territoires de l’Est, Colomb-Béchar, les Knadsa, la Saoura, les Touat et Tidikelt.
Territoires marocains du Sud : Tindouf, Rio-de-Oro, Mauritanie
Sans remonter à l’histoire relativement ancienne où les sultans du Maroc ou leurs représentants faisaient leur entrée à Tombouctou sans que personne eût l’idée de leur contester le droit de visiter les régions périphériques de leur royaume, nous puiserons nos arguments dans les écrits de ceux-là mêmes qui ont fait la conquête de ce qu’on a appelé pendant près d’un siècle l’« Empire français d’Afrique ». Quand on sait à présent que Tindouf, jusqu’en 1952, relevait de Rabat et que c’était le commandement d’Agadir qui réglementait dans cette région la circulation des personnes et des marchandises, il est pour le moins « osé »de voir affirmer que cette contrée n’a jamais été marocaine. Tantôt « confins marocains », tantôt « confins algéro-marocains », tantôt « confins sahariens et enfin « territoires sahariens indépendants », l’on voit à travers ces appellations, qui ont duré chacune pendant des périodes plus ou moins courtes selon les fluctuations politiques, l’embarras des responsables à fixer cette région dans un ensemble qui pourrait ne plus souffrir de discussion. Ce n’est là qu’un exemple parmi tant d’autres qu’illustre s’il en était besoin l’inanité d’une thèse aujourd’hui officielle que le Sahara est terre française.
De l’époque des Almoravides (1053), son histoire, ses manifestations sur le plan religieux, ses transformations politiques et sociales, se sont toujours inscrites dans le cadre des événements que l’ensemble du Maroc a connus durant cette période. Cette réalité historique, géographique et ethnique ne peut être mise en doute du seul fait que certaines puissances européennes ont besoin du fer ou du pétrole qui a été découvert ou qui peut l’être dans ces contrées. Là est un second problème qui pourrait trouver sa solution du fait même que l’exploitation des richesses sahariennes exige des capitaux importants et nombre de techniciens dont disposent ces puissances. Mais cette capacité d’exploitation dont elles disposent ne leur donne pas automatiquement droit à la souveraineté sur la terre et sur ses habitants au détriment du droit, de l’histoire, de la géographie et par surcroit de la volonté des populations.
« La fonction propre, l’originalité du Maroc, c’est d’être à tous égards le lien, le lieu de passage, entre l’Europe méditerranéenne et l’Afrique tropicale. Ignorer soit ce qui lui est venu par le Sahara, soit le rayonnement de son action à travers le désert, c’est le mutiler et se condamner à ne pas le comprendre. »
Ainsi s’exprimait le géographe J. Celerier en 1930 au huitième congrès de l’Institut des hautes études marocaines.
Avant lui A.-G.-P. Martin, dans son livre Quatre siècles d’histoire marocaine, au Sahara de 1504 à 1902, au Maroc de 1894 à 1912, constatait :
Le Sahara marocain relève au début du siècle de deux khalifas, le lieutenant chérifien « pour le Sahara », qui réside au Tafilalet, et celui de Marrakech dont dépendent le Sous et la Séguia-EI-Hamra « qui joue, elle aussi, le rôle de pédoncule politique rattachant l’Islam maghrébin ; les musulmans de tout le Sahara sud-occidental, dont les Européens, ainsi que nous aurons l’occasion de le constater, n’ont pas observé la communauté de vie politique avec l’Empire chérifien ».
L’on sait maintenant dans quelles conditions, dans quelles circonstances et dans quels buts étaient passés les fameux accords « secrets » de 1901 et 1902 entre la France et l’Espagne. L’on sait aussi de quel poids pesaient la Grande-Bretagne et l’Allemagne sur ce partage « secret » entre la France et l’Espagne des territoires marocains. Œuvre de géomètres, penchés sur des cartes plus ou moins approximatives, qui, sans tenir aucun compte ni des données géographiques ou naturelles ni même des considérations de tribus ou de populations, ont décrété que c’est le méridien 11° ouest de Paris et le parallèle 27° 40 de latitude nord qui détermineraient les zones d’influence et plus tard les zones d’occupation de l’une et l’autre puissance. Plus tard encore on découvrit que pour relier cet ensemble à un point géographique fixe, par exemple Colomb-Béchar, il subsistait un hiatus de 700 kilomètres sans frontières. Bien entendu ce n’était pas au Maroc (protectorat et non colonie ou province française) qu’il convenait de rattacher ce territoire appendice. Ce fut alors le bon vouloir des officiers des affaires indigènes qui réglait localement ces questions d’importance mineure à l’époque. C’est ainsi que virent le jour les lignes Trinquet et Varnier.
Le fait est que le 31 mars 1934 le colonel Trinquet occupe Tindouf (en partant du Maroc et en application de la coopération due au sultan pour y établir son autorité effective), et réalise le 7 avril à EI-Gardane la liaison avec un groupe venu de Mauritanie. Peut-il le faire au nom de la France, le Maroc étant un protectorat français soumis aux principes de l’Acte d’Algésiras ? Sur quelles bases conventionnelles franco-marocaines la France peut-elle s’appuyer pour régler la question de Tindouf ? L’argument basique nous est donné par Louis Le Guillou (Ecrits de Paris, n° 153, page 75) :
« …Si nous avons un peu arrondi les frontières de notre Sahara algérien ce n’est qu’une juste compensation pour les milliards que nous avons engloutis dans la guerre de pacification marocaine et pour toutes les vies françaises que nous y avons sacrifiées. »
Pour « arrondir un peu les frontières » on oubliait trop vite en France que les accords, qui étaient « secrets » au début du siècle, ne le sont plus aujourd’hui, et que d’autres conventions internationales, notamment celle franco-allemande de 1911, définissaient le Maroc comme le territoire « comprenant toute la partie de l’Afrique du Nord s’étendant entre l’Algérie, l’Afrique-Occidentale française et la colonie espagnole de Rio-de-Oro ».
Quand on sait que la Mauritanie n’a été intégrée dans l’A.-O.F. qu’en 1920 après avoir été déclarée colonie et qu’à l’instar d’autres régions du Maroc (les Aït-Baamrane notamment), elle résista vaillamment à l’occupation étrangère, longtemps après l’établissement du protectorat français en 1912, on ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’a aucun lien avec le Maroc et qu’elle n’est pas une partie intégrante du royaume. Notons d’autre part qu’en février 1897 Mâa-el-Aïnine vint en personne jusqu’à Marrakech et présenta au prince des Croyants son acte d’hommage. Plus tard, dès réception de l’appel des tribus de Tagout, le sultan avait envoyé à ses sujets des armes ainsi qu’un de ses cousins, Moulay Idriss, avec mission de voir sur les lieux quelle était leur situation et de les soutenir vis-à-vis de l’envahisseur. À la démarche diplomatique faite par la France le sultan n’hésita pas à reconnaître la mission par lui donnée à Moulay Idriss et s’étonna même qu’on essayât de se mêler des affaires intérieures de son empire.
On s’est ingénié tout au cours du vingtième siècle à justifier après coup l’occupation militaire par des puissances coloniales de territoires avec lesquels elles n’avaient aucun rapport auparavant. C’est ainsi que nombre de principes sont nés et furent introduits dans les instances internationales et les organisations mondiales, tels « la volonté des populations », « le self-gouvernement ». C’est un vocabulaire qui a pris racine, qui est de plus en plus usité, et c’est en l’utilisant et en défendant de tels principes que l’on devient aux yeux du monde le champion de la liberté et de la démocratie. L’absurdité pourtant de l’application intégrale de tels principes ne saurait échapper. Que dirait-on si l’on demandait à la population de Liverpool ou de Marseille d’exprimer sa volonté et de dire : la première si elle est anglaise et la seconde si elle est française ? En transposant au Maroc on se demanderait également s’il est réellement logique de demander à la population de Fès ou de Marrakech de dire si elle est marocaine ou autre chose. C’est dans ces termes que se pose pourtant la question de savoir si la population de Tindouf ou de Fort-Gouraud est ou non marocaine.
Mais prenons ces principes tels qu’ils sont libellés et tels qu’ils sont utilisés dans les instances internationales. Et rappelons pour mémoire que la manifestation de la volonté des populations sahariennes marocaines n’a jamais fait défaut. En dehors des protestations que les chefs religieux et administratifs de ces territoires n’ont pas manqué d’élever à différentes reprises et en dehors des réclamations faites par les chefs politiques, exprimant les vœux des populations en vue de recouvrer leur indépendance et leur attachement au Maroc, rappelons que le 25 février 1958 S.M. le roi Mohammed V déclarait aux portes du Sahara :
« Notre joie est immense d’être accueilli à Mhamid-les-Gazelles par les fils de ceux qui avaient reçu notre ancêtre Moulay Hassan : Reguibat, Chenguitt, Takna, Ouled-Dlim et autres tribus sahariennes. Notre joie est immense, disons-nous, de nous trouver au milieu d’eux, de nous entretenir avec leurs hommes de loi et de lettres et de les entendre nous réaffirmer, comme leurs ancêtres l’avaient fait à notre grand-père, leur fidélité au trône alaouite et leur attachement à la nation marocaine, unie et indivisible. »
Ces tribus, venues accueillir le roi, n’étaient autres que les populations de Sagnia-el-Hamra et de la Mauritanie.
Rappelons également que le 30 mars 1958 Mohamed Fall Ould Oumeir, émir des Trarza et conseiller directorial de la Mauritanie, est venu à Rabat faire acte officiel d’allégeance au roi du Maroc. (La province des Trarza s’étend du djebel Adrar jusqu’au fleuve Sénégal. C’est la province limitrophe dont la limite sud-est, la frontière naturelle avec le Sénégal que constitue le fleuve Sénégal.)
L’émir des Trarza était accompagné du ministre de l’éducation nationale, Mohamed El Mokhtar Ould Bah ; du ministre du commerce, de l’industrie et des mines, Dey Ould Sidi Baba, secrétaire général de l’« Entente mauritanienne », et du cheikh Hamadou, président des Jeunesses mauritaniennes.
Bien avant leur arrivée à Rabat l’ancien député Horma Ould Babana déclarait en France même que la Mauritanie faisait partie intégrante de l’Empire chérifien.
Aujourd’hui plusieurs chefs religieux et politiques sont à Rabat. Par tous les moyens dont il dispose le peuple mauritanien leur exprime sa confiance et son soutien. Il exprime ainsi sa volonté de vouloir rester « marocain » malgré les pressions dont il est l’objet et malgré les promesses alléchantes et les manœuvres auxquelles se livrent les « glaouis » mauritaniens et leurs acolytes. Point n’est besoin bien entendu de s’engager dans une polémique. La réalité historique, géographique, ethnique et politique permettrait amplement à ceux qui ne veulent pas, par entêtement, marcher contre le courant de l’histoire, de considérer que les temps de la domination par la force ou par la ruse sont à jamais révolus.
Territoires marocains du Sud-Est : Béchar, Kenadsa, Saoura Touat et Tidikelt
Le même processus a été suivi pour l’occupation de ces régions. Depuis 1830 et durant toutes les longues années qu’a duré la pénétration française en territoire algérien les mêmes problèmes s’étaient posés à l’occupant militaire pour détacher peu à peu du territoire marocain des régions qui en faisaient partie intégrante. Sans considération des données géographiques ou de frontières naturelles l’on procéda sur la base d’un principe qui s’est révélé fort utile et fort efficace, et que Henri Hauser dans son livre Du libéralisme à l’impérialisme résumait d’une façon heureuse : « Les agents français faisaient, semble-t-il, la sourde oreille aux propositions marocaines de délimiter les frontières de 1845. Il y avait intérêt à laisser subsister le vague. »
La frontière étant un obstacle pour la future liberté française, que pouvait-on faire de mieux que de la laisser imprécise, telle qu’elle existait entre le Maroc et l’Algérie avant la conquête de celle-ci par les Français, entre le Maroc et le Sahara depuis le commencement du monde ?
Jamais les clauses d’un traité ne furent plus obscures que celles du traité de délimitation conclu à Lalla-Marnia le 18 mars 1945. « Le Sahara (désert), il n’y a pas de limite territoriale à établir entre le Maroc et la France (sic), puisque la terre ne se laboure pas et qu’elle sert seulement de pacage aux Arabes des deux empires, qui viennent y camper pour y trouver les pâturages et les eaux qui leur sont nécessaires. Les deux souverains exerceront de la manière qu’ils entendront toute la plénitude de leurs droits sur leurs sujets respectifs dans le Sahara. » Et après avoir désigné quelques ksoums du territoire marocain et du territoire algérien, le traité ajoute :
Quant au pays qui est au sud des kessours des deux gouvernements, comme il n’a pas d’eau, qu’il est inhabitable et que c’est le désert proprement dit, la délimitation en serait superflue.
Les négociateurs d’alors ne s’étaient pas avisés que s’il n’y avait pas d’eau il y aurait peut-être du pétrole et du fer. Mais pouvaient-ils dès cette époque imaginer que ces produits allaient être la clé de puissance et les matières qui dominent notre monde ?
Là n’était pas la question. Mais la liberté d’action était acquise, et c’était l’essentiel.
Laissant de côté les clauses des traités maroco-ottomans, la pénétration française s’est poursuivie au détriment des droits des gens et malgré la résistance des populations et leurs protestations.
D’aucuns, pour justifier cette occupation, allaient jusqu’à dire qu’il s’agissait de territoires abandonnés, inoccupés ou en tout cas pas ou peu administrés, et que les habitants ne demandaient pas mieux que d’être gouvernés.
Pour répondre à cette façon de concevoir les choses un retour en arrière nous parait nécessaire et une observation préalable s’impose. Les régions marocaines des Ksoums, des oasis de Touat et de Tidikelt présentaient une ressemblance complète avec ce qu’étaient les bourgades de la France du Moyen Âge, abritées sous les remparts de leur château.
Les liaisons de la capitale du Maroc (Fès, Marrakech, Meknès ou Rabat) avec les Touat ou Tidikelt ne différaient en rien de ce qu’étaient les relations de Paris avec n’importe quelle localité des Pyrénées ou des Alpes au début du siècle dernier. La voie ferrée n’avait pas encore sillonné du nord au sud et d’est en ouest toutes les grandes villes et toutes les petites bourgades, l’avion et l’hélicoptère n’avaient pas encore réduit les distances dans des proportions considérables et le téléphone ou la télégraphie sans fil n’avaient pas encore rendu instantanée la communication entre Paris et Perpignan. Ainsi en était-il entre Rabat et Reggane ou Chenguitti.
Notons que de tout temps, et jusqu’à l’occupation militaire française, tous les attributs de la souveraineté marocaine s’exerçaient dans les Kenadsa, la Saoura, les Touat et Tidikelt : la monnaie, les poids et mesures ; la levée des impôts ; les caïds, pachas et gouverneurs étaient nommés par le pouvoir central ; la prière était dite au nom des souverains régnants (voir l’ouvrage déjà cité de A.-G.-P. Martin : Quatre siècles d’histoire marocaine).
Sans remonter aux règnes des Chorfas filaliens, Moulay Ali et Moulay Abdallah, fondateurs à la fin du quinzième siècle de Zaouiet-Reggane et de plusieurs ksours des Touat, nous rappellerons pour mémoire qu’en 1830, début de l’occupation française en Algérie, le sultan Moulay Abderahmane se penchait avec sollicitude sur le sort de ses sujets habitants des Touat, qui traversaient une période de disette, et leur confirmait l’exonération d’impôt. Voici son message :
À nos serviteurs fidèles, à tous les habitants du Gourara et du Touat, Chorfa-Merabtines, roture, cadhis et jurisconsultes, que le salut, etc.
Et ensuite vous êtes sans aucun doute partie intégrante de notre peuple fortuné et vous comptez parmi ceux qui se dévouent à notre service chérifien, puisque nos envoyés sont allés au milieu de vous et en sont revenus sans incident, nous rapportant ce dont vous les avez chargés comme produits de l’âchour et autres impositions.
Vous avez bien agi et vous serez félicités pour votre fidélité et votre empressement à verser ce que vous deviez.
Et toi, notre cousin, cadhi Moulaï Ahmed, sache que tu dois visiter en Personne tous ces pays de Gourara Tidikelt et Touat, et donner lecture à tous de notre présente lettre.
Nous suivons l’exemple de notre seigneur et aïeul Slimane en n’exigeant pas votre zekat ni votre âchour, par mesure de pitié à votre égard ; remettez cela aux pauvres et aux faibles, employez-le à l’entretien de vos mosquées, toutes dépenses qui vous incombent : nous prescrivons à chaque chef de district de pourvoir à ces dépenses en notre nom car nous renonçons de nous-même aux impôts et nous en affectons le produit à ces besoins et à tous ceux d’entre vous qui sont dans le dénuement.
Nous te prescrivons, ô cadhi, de te tenir en correspondance avec notre frère Moulaï Ahmed Ben Abdelouahad, qui réside au pays de nos pères, le Tafilelt, et y est notre représentant et lieutenant, de même que notre fils Sidi Mohammed est notre lieutenant à Tetouane et dans sa province.
Nos envoyés nous ont fait connaître la misère de votre pays ; surtout ils nous ont apporté le recensement de vos eaux et de votre récolte ; nous y avons constaté une grande diminution par rapport à ce qu’avait donné le recensement fait au temps de notre seigneur et aïeul, et nous avons compris la misère de votre pays (cf. sup. pp. 107, 124 et 141).
C’est pour cela que nous cesserons d’envoyer chez vous nos serviteurs qui pourraient avoir vis-à-vis de vous des exigences injustifiées et inconsidérées, ainsi que nous savons qu’ils en montrent envers des populations plus proches de nous ; ils garderaient moins encore de mesure vis-à-vis de vous qui êtes éloignés.
Si rien ne s’y oppose, tu recevras de nous, toi cadhi, avec la bénédiction divine, une certaine somme (d’argent) que tu répartiras entre tes frères et les chorfas âlouyites, et des présents que tu déposeras de notre part dans les sanctuaires et les mausolées de ton Pays ; tu es notre mandataire.
Envoie-nous la liste de tous les chorfas actuellement vivants dans le Touat, et que Dieu, etc.
Du commencement de redjeb 1245 (16 janvier 1830).
À la suite des pillages et des incursions entrepris dans leur région en 1829 et 1830 certains cheikhs et chorfas du Touat avaient adressé leurs plaintes au souverain.
À nos serviteurs fidèles, répondit l’émir, à tous les cheikhs du Gourara, du Touat et de Tidikelt, que le salut, etc. Et ensuite sachez que notre bienveillance et notre main protectrice s’étendent toujours sur vous.
Vous êtes partie intégrante de notre empire fortuné ; appliquez-vous à conserver la patience et soyez miséricordieux.
Que Dieu vous protège et vous dirige, salut. » Du 12 ramadhane 1248 (2 février 1833).
Dès le milieu du dix-neuvième siècle les menaces françaises s’étant fait sentir, les populations du Touat et les oasis s’émurent et adressèrent à leur souverain (Sidi Mohamed Ben Abderahmane) une pressante réclamation contre l’entreprise des chrétiens, attentatoire à leur liberté.
Et voici ce que leur répond le sultan :
Louange à Dieu, etc. » À nos serviteurs magnanimes, les notables du Touat, que Dieu, etc.
Nous avons reçu votre lettre et avons pris connaissance de son contenu.
Nous avons appris ainsi les tentatives faites par certains que vous n’avez pas suivis pour provoquer des troubles entre vous et vos voisins du territoire des roumis, leurs excitations à votre, égard et leur désir d’ouvrir jusqu’à vous les voies d’accès qui sont restées fermées jusqu’ici.
Vous nous avez demandé de vous écrire une lettre d’exhortations pour vous recommander de vous entendre i les uns les autres, et d’être comme une seule main contre ceux qui tenteront encore de semblables entreprises, afin d’éviter tout souci et que chacun ait à rester dans ses frontières : nous le faisons par la présente et nous demandons à Dieu de nous satisfaire les uns et les autres.
Du 10 choual 1280 (19 mars 1864).
Plus tard le sultan Sidi Mohammed fut de nouveau saisi de plaintes et réclamations contre les agissements des voisins (roumis). Il décida l’envoi sur les lieux d’un de ses caïds, le caïd Mansour, porteur du message ci-après :
À nos serviteurs fidèles, les gens du Touat, que le salut, etc.
Ensuite nous avons reçu votre lettre portant que Burin, chef français de Géryville, dans la province d’Oran, était venu jusqu’à Bel-Ghazi en compagnie de Bou Beker Ben Hamza, et que son arrivée vous avait causé des inquiétudes.
Nous avons pris note de cela et nous avons envoyé un de nos serviteurs à Tanger pour demander la raison de ce voyage au représentant du gouvernement français ; celui-ci a déclaré que le voyage de cet homme n’avait eu pour but que d’explorer le pays et d’en dresser la carte, sans causer de dommage à personne.
Nous vous recommandons de vous comporter envers ceux qui pourront venir encore de façon à ne leur causer aucune inquiétude, mais de vous écarter d’eux, de ne pas faire d’opérations commerciales avec eux ou avec leurs négociants, et si quelqu’un (musulman) apporte chez vous des marchandises de chez eux, saisissez-les entre ses mains.
Et toi, El Hadj Mohammed, nous t’envoyons nos félicitations pour toi et ton fils Hassoun, cheikh du Timmi, et certes nous te décernons, s’il plaît à Dieu, une récompense éclatante.
De plus nous te recommanderons, ainsi que ton fils, aux émirs, nos successeurs.
Quant au gouvernement français, sachez que nous ne lui attribuons que de bonnes intentions.
Nous chargeons notre serviteur, le caïd Mansour, de porter jusqu’à Aïoun-Salah les lettres que nous y envoyons ; que votre pays et vos notables lui ménagent un bon accueil. Salut.
Des derniers jours de choual 1282 (7-17 mars 1866).
Tous les rois du Maroc qui se sont succédé sur le trône pendant cette seconde moitié du dix-neuvième siècle s’attaquèrent à ces problèmes de frontières, de jour en jour violées et menacées par les troupes françaises. Moulay Hassan notamment mena une grande œuvre de réorganisation pour assurer la défense du territoire national sans se départir à aucun moment de son action diplomatique, et auprès des habitants exaspérés par les attaques il usa de toute son influence et de sa sagesse pour éviter la généralisation de la guerre, comme en témoigne le message du sultan :
« À nos serviteurs fidèles, les habitants du Touat, Chorfa, Merabtines et gens de roture, que Dieu, etc. »
Ensuite votre lettre nous est parvenue, traitant de votre fidélité et de votre constance à maintenir le bon ordre, de même qu’est arrivée la députation que vous avez chargée de nous visiter en votre nom et de nous présenter vos doléances au sujet des soucis que vous causent les Français sur les frontières de votre pays et de leur pénétration inévitable au milieu de vous. Vous avez envoyé en même temps dix nègres ou négresses en présent à notre personne chérifienne.
Pris bonne note de tout cela.
otre députation vertueuse s’est présentée à nous et a été bien reçue, elle a profité de nos faveurs et de c notre meilleur accueil ; elle vous a représentés de la manière la plus heureuse et nous a donné connaissance de tous vos messages.
Nous avons aussi reçu votre présent de nègres et l’avons accepté selon l’esprit de la Sonna du Prophète avec une satisfaction particulière ; nous les avons accueillis avec bonté et leur avons réservé un service agréable selon que le leur et souhaité Noé -sur lui soit le salut.
Quant au gouvernement français, il n’a eu jusqu’ici avec nos nobles ancêtres que des rapports d’amitié ; il a montré sa fidélité aux traités de paix, son respect des droits de ses voisins et sa manière d’agir équitable ; nos engagements réciproques s’en sont affermis et consolidés et il s’en est suivi entre notre gouvernement fortuné et le gouvernement français une paix durable et des relations amicales, cela a été constaté par des textes écrits contenant toutes sortes de citations et d’arguments. C’est au point que si leur bon droit vient à être méconnu en quelque affaire, les Français iront jusqu’à s’abstenir de réclamer et à conserver une attitude calme par considération pour l’objet de leur amitié.
Ils n’agiront contre personne sans que leur action soit appuyée sur quelque motif équitable et ils ne causeront aucun préjudice à leur voisin que celui-ci ne se le soit attiré lui-même ; si donc vous restez à leur égard dans la limite de vos droits, prenant en cela modèle sur vos pères, vous n’éprouverez de leur part aucun mauvais procédé ni dommage, et vous n’aurez à supporter d’eux aucune injustice au long des âges – par la puissance de Dieu.
Quant à nous, nous n’épargnerons pas nos efforts pour vous être utile et vous assurer la réussite de vos désirs ainsi que le maintien de la paix et de la tranquillité – par la puissance de Dieu.
Nous demandons à Dieu – qu’Il soit exalté – de consolider les bonnes relations que nous espérons entretenir, de nous maintenir dans ce que nous nous proposons, de bonnes intentions, et de nous être favorable, à nous et à vous, dans la mesure de ce qui lui sera agréable. Salut.
Du 7 moharrem 1305 (25 septembre 1887).
De nombreux documents et le témoignage direct rapporté par tous ceux qui participèrent à l’administration et à la réorganisation de ces régions peuvent être cités. Il serait fastidieux d’en faire état dans cet exposé succinct. Donnons simplement pour illustrer l’exercice de la souveraineté marocaine sur ces régions le Tableau de commandement des oasis en 1892 tel d’ailleurs que le donne A.-G.-P. Martin dans son livre déjà cité (p. 261). Il écrit :
Nous ne nous arrêtâmes pas à citer en détail les dates et les conditions des nominations de tous les fonctionnaires, caïds, nekhibs et cadhis que le sultan nomma alors et dont une partie reçut ses brevets en dehors de l’intermédiaire de Ba-Hassoun pendant les mois qui suivirent son départ de la cour chérifienne ; nous en donnons un tableau général présentant l’organisation complètement achevée :
a) Ordre administratif :
Caïd Hassoun Ben El Hadj Mhammed, chargé de la centralisation des impôts de toutes les oasis ;
1. – Caïd Mhammed Ben El Hadj Abdelkader : In Hammou I Tâantast I – Tazliza 1 – Sidi Mansour I -Tabelkoza I ;
2. – Caïd Abdelkerim Ben MohamMed Fatis I, Zaouïet – Debbagh I -Oudghagh 1 – Oulad Aïach I ;
3. – Caïd El Hadj Ahmed Ben El Arbi : El Haïha 1 – Oulad Aïssa 1 ;
4.-Caïd El Mahfoudh Ben Cheikh : Oulad Saïd 1 – Semmota 1 -Beni Mehlal 1 – Lichta 1 – Kali 1 -Aghlad I ;
5. – Caïd Mohammed El Mâzouz : Talmine S ;
6. – Caïd Kouider Ben El Hadj Abdesselam : El Kef 1 – El Hadj Guelmane 1 – Taghit I – Badriane I – Tous les khenafsa du Gourara ;
7. – Caïd Brahim Ben Abdelhaï : Charouine 1 – Takoulzi I ;
8. -Caïd Mohammed ou Salem Ben Abderrahmane – Timmimoun S -Oulad Tahla S – Taoursit S – El Ouadjda S – Sahela S – Charef S – Bou Guemma S – Akbour S – Tasfaout S -Zaouïet Sidi Amor S ;
9. – Caïd Mhammed Ben Cheikh : Tiberghamine I – Ksar El Hadj – 1 Tinakline 1 – Tala Aboud 1 – Zt Sidi Abdallah I ;
10. – Caïd EE Hadj Amor Ben El Hadj Ahmed : Deldoul 1 – Oulad Mahmoud I – Oulad Rachid I – Oulad Ali I Metarfa I – Kaberten I ;
11. – Caïd Mohamed Ben Mohammed : Brinken S – Hammad S -Amour S – Keda S – Oudjlane S -Oufrane S – Sebâ S ;
12. – Caïd Mohammed Abdelkader

Ben El Hadj Belkassem : Bouda en entier S – Tamentit S – Bou Faddi S -Abbani S – El Allouchïa S – Oudgagh S – Ben Hemi S – El Mansour S -Noum en Nas Gharmïannou S -Tazoult S ;
13. – Caïd Hassoun Ben El Hadj Mhammed : Timmi en entier I – El Maïz I – Chorfa d’El Hebla I – Tasfaout – Azzi – Oulad Ber Rachid I -Oulad Moulaï Bou Farès I – Kasbet El Harar – Sidi Youcef I – Ba Amor I -Oulad Yahia I – Djedid I – Ouled Antar I – Ikkis I – Tamaseght I – Aghil I -Titaf I ;
14. – Caïd El Abbés Ben Djelloul : Inzegmir I – Bou Andji I – Ghezira I-El Khalfi I – Zaouier Belal I ;
15. – Caïd Mohammed Ben Yaïch -Taorirt S – Tinnourt S – Berrich S -El Mestour S – Zt El Hachef S – Aït Messaoud S En Nefis S ;
16. – Caïd El Hadj El Mehdi Ben Ba Djouda ;
17. – Caïd Mohammed Ben El Hadj Ahmed Mahmoud ;
18. – Caïd Moulaï Ali Ben Ismaïl ; 19. – Moulaï Ali Ben Chérif, nekib des chorfa d’El Hebla ;
20. – Moulaï Ahmed Ben Abdellcrim, nekib des chorfa de Sali et du Reggane, hormis Entehet ;
21. – Moulaï Ali Ben Chérif Ben Seddik, nekib des chorfa de Timmi ; 22. – Sidi Mohammed Ben Moulaï Heïba, nekib des chorfa d’Aoulef et du Tidikelt.
b) Ordre judiciaire
1. – Sid El Mokhtar Ben Mostefa, cadhi des chorfa Oulad Sidi Hammou Bel Hadj et des autres castes, Merabtines et roture de leurs ksour ;
2. – Sid Mahmmed Ben Habib El Belbali de Koussane en Timmi, cadhi du Touat et dépendances ;
3. – Sid Mohammed Abdallah El Boudaoui, cadhi de Timmimoun, Talmine, Khenafsa et Meharza, et de tout le Touat ;
4. – Sid Abderrahmane Ould El Iman, d’Aïn-Salah ;
5. – Sid Mohammed Ben Abderrahmam d’Inzegmir ;
6. – Sid Abderrahmane Ben Khaled d’Igosten, des Zoua ;
7. – Sid Mohammed Abdelkrim Ben… des Culad-Saïd ;
8. – Sid Hamza El Foullani, cadhi de la province de Tidikelt dans le Touat.
Il serait loisible à quiconque désirant rétablir la vérité historique (et il s’agit bien entendu d’une histoire récente puisque nous sommes à la veille du protectorat qui empêchera le Maroc d’engager une quelconque action diplomatique ou d’élever une protestation sur le plan international), de consulter la carte de ces régions et de constater que la souveraineté marocaine était pleinement exercée dans ces régions, aujourd’hui intégrées dans des ensembles sahariens, sans le consentement du Maroc.
Notre réclamation est fondée et nos droits sont clairs. L’ère du colonialisme est à jamais révolue et l’unification de notre territoire national, question vitale pour notre pays, demeure notre principale préoccupation. Nos revendications tendent à rétablir le Maroc dans sa réalité historique, géographique et politique. Dans son dernier discours du Trône (18 novembre 1959) Sa Majesté le roi a déclaré : « Il est naturel qu’en tête de nos préoccupations demeure… la liberté des territoires dont nous avons été spoliés et le retour sous notre souveraineté de ceux de nos sujets qui ont été séparés de leur patrie contre leur propre volonté et sans le consentement de l’autorité légitime. »
Quant à nos rapports futurs avec nos frères voisins d’Algérie, aucun litige ne peut nous opposer. Ils sont comme nous décidés à réaliser l’unification et la construction du Maghreb arabe sur la base des résolutions prises à la conférence de Tanger.
Notre désir est grand de voir participer dans une coopération libre et féconde d’autres nations amies à la mise en valeur de ces vastes régions et à l’exploitation de leurs richesses naturelles pour le bien-être et le progrès des populations.

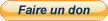
Comments